Dossier | Travail et consommation : nouvelles pratiques dans un monde en mutation
Eco-Score : un nouvel outil pour des choix alimentaires responsables ?

Pour aider les consommateurs et encourager les entreprises, les pouvoirs publics envisagent la création d’un Eco-Score, affiché sur les produits alimentaires. Si le Nutri-Score a déjà prouvé son efficacité, la coexistence de plusieurs labels sur les emballages soulève des questions pratiques. Ajouter un Eco-Score aurait-il vraiment un impact ?
L’alimentaire représente près d’un quart de l’empreinte carbone de la consommation des ménages. L’industrie agro-alimentaire fait donc partie des secteurs prioritaires pour la transition écologique. Le ministère de la Transition écologique et l’Ademe ont envisagé la mise en place d’un système d’affichage environnemental des produits alimentaires afin d’informer les consommateurs et d’orienter leurs choix vers une consommation plus vertueuse. Indirectement, l’objectif est aussi d’inciter les fabricants et les distributeurs à initier et valoriser leurs démarches d’éco-conception. Il s’agit ainsi de proposer un outil de management pour encourager la production durable.
Les enjeux environnementaux sont nombreux et interdépendants : neutralité carbone, réduction des gaz à effet de serre, maintien de la biodiversité, protection des ressources en eau, qualité des sols, réduction de la toxicité environnementale… Et ils doivent être considérés à toutes les étapes du cycle de vie, de l’agriculture à la consommation, en passant par la transformation, l’emballage, le transport et la distribution. Cette complexité pose de nombreuses questions au moment de synthétiser l’information pour qu’elle soit facilement compréhensible par le consommateur. C’est avec cet objectif que les pouvoirs publics réfléchissent à un format d’affichage unique pour informer sur l’impact environnemental des produits alimentaires.
Un « Nutri-Score » environnemental ?
Ce format pourrait s’inspirer du Nutri-Score, déjà présent sur la plupart des emballages, et dont l’efficacité a été largement démontrée (Dubois et al., 2021). En effet, il procure aux consommateurs un accès simple et rapide à l’information sur la qualité nutritionnelle des produits en magasin. C’est aussi un repère pratique pour comparer la qualité nutritionnelle des produits au sein d’une même catégorie, sans nécessiter leur prise en main et la lecture des informations détaillées sur l’arrière de l’emballage. Enfin, des données montrent également que le Nutri-Score a permis d’inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. C’est ce que montre notamment une enquête UFC-Que Choisir de 2023 pour trois rayons étudiés : pains spéciaux, céréales de petit-déjeuner, et barres céréalières.
Toutefois, avec ce double enjeu en matière d’information et de prévention des risques dans le domaine alimentaire – santé et environnement – les pouvoirs publics prennent le risque de semer la confusion chez les consommateurs. Lorsqu’ils sont soumis à trop d’informations, les consommateurs, contraints par le temps, ont tendance à ignorer une partie des informations, ce qui peut contribuer à réduire l’efficacité des dispositifs mis en place. De plus, l'ajout d'un étiquetage environnemental sur les emballages des produits alimentaires soulève plusieurs questions concernant l'éventuelle contradiction entre les scores environnementaux et les scores nutritionnels.
S’il est prouvé que les aliments plus sains ont tendance à être plus durables (Clark et al., 2019), ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, des produits sucrés de faible qualité nutritionnelle peuvent avoir un faible impact sur l’environnement lorsqu’ils sont produits localement. À l’inverse, des plats à base de protéines animales issues de l’industrie mondiale pourront être de bonne qualité nutritionnelle mais avec un impact fortement négatif sur l’environnement.
L’Eco-Score est-il efficace auprès des consommateurs ?
Pour savoir si la présence simultanée d’étiquetages nutritionnels et environnementaux atténue l'efficacité de l’un ou l'autre dispositif, nous avons mené une étude expérimentale en ligne dans laquelle 462 répondants devaient indiquer leur intention d’acheter un paquet de céréales de petit-déjeuner d’une marque fictive nommée Compliment. Les variables manipulées étaient l’Eco-Score (Absent, B ou D) et le Nutri-Score (Absent, B ou D). Chaque répondant devait indiquer son intention d’acheter le produit à 3 reprises :
- D’abord sur un produit ne comportant aucun label
- Ensuite sur un produit affichant un seul label (aléatoirement Nutri-Score B, Nutri-Score D, Eco-Score B ou Eco-Score D)
- Et enfin sur un produit affichant les 2 labels de manière aléatoire, chacun B et/ou D (toutes les combinaisons étaient représentées).
Les répondants devaient également répondre à un court questionnaire de sensibilité environnementale et leurs intentions d’achat étaient ensuite comparées selon les conditions.
Nos résultats montrent que, conformément à la littérature sur l’asymétrie entre les informations positives et négatives (Kahneman et Tversky, 1979), un Eco-Score défavorable produit plus d’effet qu’un Eco-Score favorable. En effet, l’Eco-Score B n’améliore pas significativement l'intention d'achat par rapport à un produit sans étiquetage, alors que l’Eco-Score D joue son rôle dissuasif en réduisant l’intention d’achat pour les produits à fort impact.
Alors qu’un seul étiquetage favorable (Eco-Score B ou Nutri-Score B) n’est pas suffisant pour modifier les intentions d’achat, la présence simultanée de deux étiquetages favorables (Eco-Score B et Nutri-Score B) améliore significativement celles-ci. De même, les effets dissuasifs des scores D se cumulent, de telle sorte que la présence de deux scores défavorables détériore très fortement l’intention d’achat.
Entre Nutri-Score et Eco-Score, qui l’emporte ?
Lorsque les scores ne sont pas concordants, il est intéressant, et rassurant du point de vue des politiques de santé publique, de constater qu’un Eco-Score favorable (B) ne permet pas de compenser totalement un mauvais Nutri-Score (D). En revanche, un bon Nutri-Score (B) peut venir annuler l’effet dissuasif d’un mauvais Eco-Score, ce qui pose la question de l’efficacité de l’étiquetage Eco-Score lorsqu’il n’est pas cohérent avec le Nutri-Score. On constate aussi que l’Eco-Score produit des effets plus forts chez les personnes ayant une forte sensibilité environnementale, ce qui traduit le fait que le dispositif est plus efficace chez les individus déjà convaincus par la cause environnementale.
Pour résumer, cette première expérience confirme l’efficacité d’un Eco-Score défavorable pour détourner les individus des produits à fort impact environnemental. Elle montre également la supériorité du Nutri-Score sur l’Eco-Score, mais ne permet pas de dire s’il s’agit d’un effet de familiarité avec le logo (donc susceptible de s’estomper au fil du temps), ou s’il s’agit d’un biais de proximité plus tenace (le Nutri-Score fait référence à des risques personnels alors que l’Eco-Score fait référence à des risques collectifs, pour les générations futures).
Les défis de l’Eco-Score
Les recherches en marketing social montrent que la communication est indispensable pour susciter l’adhésion des consommateurs aux mesures de santé publique et favoriser les changements de comportement. Mieux informer pour orienter les choix vers des produits ayant un plus faible impact environnemental – végétal, local, issu de l’agriculture biologique – est un enjeu de société majeur. Toutefois, cette communication comporte encore de nombreuses difficultés liées aux contextes informationnels (multiplication des labels), individuels (capacité à comprendre facilement l’information, pouvoir d’achat, sensibilité aux questions environnementales) et marketing.
Cette première expérience doit être complétée pour mieux comprendre les arbitrages des consommateurs et orienter les pouvoirs publics vers les dispositifs les plus efficaces, et ceci à trois niveaux. Le premier est celui du format de l’étiquetage environnemental, qui doit être à la fois simple à appréhender par le consommateur et fidèle à la réalité de l’impact du produit. Le second niveau est celui des populations à qui cet étiquetage s’adresse, notamment en matière de connaissances environnementales préalables et de contraintes budgétaires. Enfin, le troisième niveau est celui de ses leviers d’acceptabilité par les filières et les industriels, avec une approche qui ne soit pas perçue comme punitive et qui permette de valoriser leurs efforts.
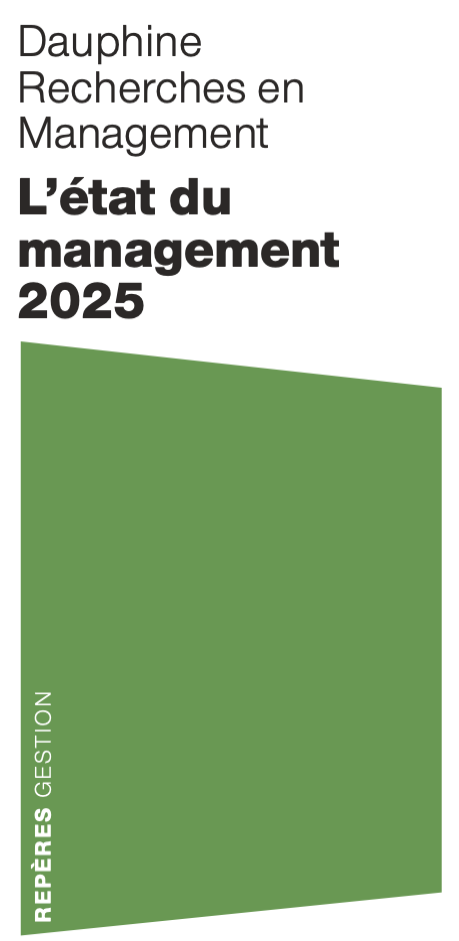 | Cet article est publié dans le cadre de la parution de L’état du management 2025, aux éditions La Découverte. L’ouvrage aborde les nouvelles problématiques posées aux entreprises à l’heure de l’Anthropocène, et leurs conséquences sur les enjeux managériaux. |
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
À lire aussi
La critique des relations entre les industriels et l'État se concentre souvent autour de la question des conflits d'intérêts. Une réflexion...
Crises climatiques, chocs géopolitiques et ruptures technologiques fragilisent durablement les organisations. Quelles pratiques permettent de...
La démocratisation de l’entreprise est souvent présentée comme une réponse aux critiques sociales et écologiques. Dispositifs de RSE et espaces de...






