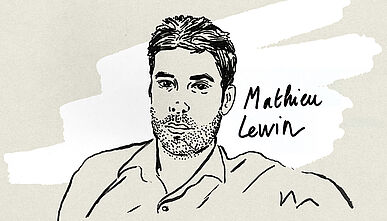Dossier | Au-delà de l’achat : les nouveaux territoires de la consommation
Quand l’intelligence artificielle devient LE consommateur
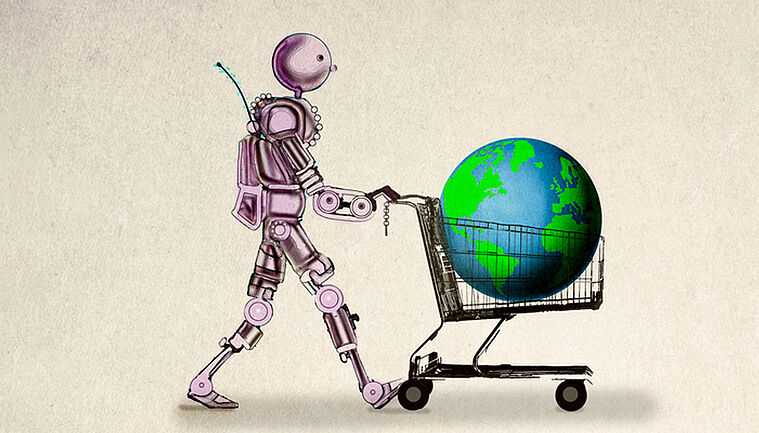
L’intelligence artificielle (IA) ne se contente plus de guider nos choix : elle anticipe nos besoins et agit à notre place. En orchestrant décisions et transactions, devient-elle une entité consommatrice ? Que devient notre libre arbitre de consommateur face à un marché piloté par les algorithmes ?
Alors que les modèles classiques de comportement du consommateur reposent sur l’intention, la préférence et le choix (Bettman et al., 1998), l’automatisation introduite par l’IA transforme en profondeur la chaîne décisionnelle. En s’immisçant dans les étapes de reconnaissance des besoins, d’évaluation des alternatives, et d’achat, l’IA ne se contente plus de guider – elle agit.
Cette mutation questionne le cadre théorique du consumer agency, l’idée selon laquelle les consommateurs ont la capacité d’agir de manière intentionnelle, de faire des choix et d’exercer une influence sur leur propre vie et leur environnement. Ce déplacement progressif du pouvoir décisionnel interroge (Thiebaut, 2020). Il interpelle la nature même de l’acte de consommer : l’IA peut-elle être considérée comme un acteur de consommation à part entière ? Sommes-nous encore maîtres de nos choix ou sommes-nous devenus les récepteurs d’un système marchand autonome façonné par l’intelligence artificielle ?
Quand les algorithmes décident de notre cadre de consommation
Les algorithmes prédictifs, programmes qui anticipent des résultats futurs à partir de données passées, sont aujourd’hui des acteurs incontournables de l’environnement numérique, présents sur des plateformes telles que Netflix, Amazon, TikTok ou Spotify. Conçus pour analyser les comportements des utilisateurs, ces systèmes visent à personnaliser l’expérience en proposant des contenus et des produits adaptés aux préférences individuelles. En réduisant le temps de recherche et en améliorant la pertinence des recommandations, ils offrent une promesse d’assistance optimisée.
Toutefois, cette personnalisation soulève une question centrale : ces algorithmes améliorent-ils l’accès aux contenus et produits pertinents, ou participent-ils à un enfermement progressif dans des habitudes de consommation préétablies ?
En favorisant les contenus similaires à ceux déjà consultés, les systèmes de recommandation tendent à renforcer les préférences préexistantes des utilisateurs, tout en restreignant la diversité des propositions auxquelles ils sont exposés. Ce phénomène, identifié sous le terme de « bulle de filtre » (Pariser, 2011), limite l’ouverture à des perspectives nouvelles et contribue à une uniformisation des expériences de consommation. L’utilisateur se trouve ainsi progressivement enfermé dans un environnement façonné par ses interactions antérieures, au détriment d’une exploration libre et fortuite, le « faire les boutiques » d’autrefois.
Ce glissement remet en question l’équilibre entre l’intelligence artificielle en tant qu’outil d’assistance et son potentiel aliénant, dans la mesure où la liberté de choix et l’autonomie décisionnelle constituent des dimensions fondamentales du bien-être psychologique et de la construction identitaire (Husairi et Rossi, 2024, p. 4).
Il soulève également des enjeux éthiques majeurs : dans quelle mesure l’expérience de consommation est-elle encore véritablement choisie, lorsqu’elle est orientée, voire imposée, par des algorithmes, souvent à l’insu des consommateurs, notamment ceux dont la littératie numérique demeure limitée ?
Quand les algorithmes deviennent les cibles de la publicité
L’optimisation des publicités et des publications en ligne repose de plus en plus sur des critères imposés par les plateformes.
Cette tendance est particulièrement visible sur des plateformes comme YouTube, où les vidéos adoptent systématiquement des codes visuels optimisés : visages expressifs, polices de grande taille, couleurs vives. Ce format ne résulte pas d’une préférence spontanée des internautes, mais découle des choix algorithmiques qui privilégient ces éléments pour maximiser le taux de clics. De manière similaire, sur les réseaux sociaux, les publications adoptent des structures spécifiques, phrases courtes et anecdotes engageantes comme sur X, où les utilisateurs condensent leurs messages en formules percutantes pour maximiser les retweets. Cela ne vise pas nécessairement à améliorer l’expérience de lecture, mais répond aux critères de visibilité imposés par l’algorithme de la plateforme (Jordan, 2024).
Ainsi, l’objectif des annonceurs ne se limite plus à séduire un public humain, mais vise principalement à optimiser la diffusion de leurs contenus en fonction des impératifs algorithmiques. Cette dynamique conduit à une homogénéisation des messages publicitaires, où l’innovation et l’authenticité tendent à s’effacer au profit d’une production standardisée répondant aux logiques des algorithmes.
Ces formats prédominants sont-ils uniquement imposés par les algorithmes, ou reflètent-ils les attentes des consommateurs ? En effet, si les algorithmes sont conçus pour maximiser l’engagement, cela suppose qu’ils s’appuient en partie sur les comportements et les préférences des utilisateurs. Pourtant, la véritable interrogation réside sans doute dans la manière dont les algorithmes influencent, par des expositions répétées, nos propres préférences, jusqu’à redéfinir ce que nous percevons comme attractif ou pertinent.
Quand les algorithmes achètent à notre place
L’évolution de l’intelligence artificielle a donné naissance aux systèmes d’achat autonomes, qui prennent des décisions d’achat en toute indépendance. Ces systèmes reposent sur deux types d’agents intelligents (Franklin et Graesser, 1996) : les agents verticaux et les agents horizontaux.
Les agents verticaux sont des IA spécialisées dans des domaines précis. Ils optimisent la gestion des achats en analysant des besoins spécifiques. Par exemple, les réfrigérateurs « intelligents » scannent leur contenu, identifient les produits manquants et passent commande automatiquement avant même que les consommateurs ne décident eux-mêmes de passer commande.
Les agents horizontaux coordonnent quant à eux plusieurs domaines d’achat. Des assistants comme Alexa et Google Assistant analysent les besoins en alimentation, mobilité et divertissement pour proposer une consommation intégrée et cohérente. L’interaction multi-agents (Ferber, 1997) permet ainsi d’accroître l’autonomie des systèmes d’achat.
Les agents verticaux assurent la précision et l’optimisation des achats, tandis que les agents horizontaux garantissent la cohérence des décisions à l’échelle globale. Cette synergie préfigure un avenir où la consommation devient totalement ou partiellement automatisée et prédictive. Progressivement, nous ne décidons plus quand acheter, ni même quoi acheter : ces systèmes autonomes agissent pour nous, que ce soit pour notre bien ou à notre détriment !
Peut-on encore considérer le consommateur comme le principal agent de décision ?
L’accès à l’information et l’instantanéité offertes par l’IA auraient fait de nous des consommateurs « augmentés » (Stephen, 2017). Pourtant, son évolution rapide soulève désormais une question fondamentale : sommes-nous encore les véritables décideurs de notre consommation, ou sommes-nous progressivement relégués à un rôle passif ?
L’IA ne se limite plus à nous assister ; elle structure désormais un écosystème au sein duquel nos décisions tendent à être préprogrammées par des algorithmes, dans une logique d’optimisation.
Une telle dynamique soulève des interrogations profondes quant à l’avenir des modes de consommation : l’IA est-elle en passe de devenir le véritable consommateur, tandis que l’humain se limiterait à suivre un flux prédéfini ? Assistons-nous à l’émergence d’un marché où les interactions entre intelligences artificielles supplantent celles entre individus ?
Si ces technologies offrent un confort indéniable, elles posent également la question du devenir de notre libre arbitre et de notre autonomie en tant que consommateurs, citoyens et humains. Dès lors, ne sommes-nous pas à l’aube d’une révolution où l’homme, consommateur passif, s’efface au profit d’une économie pilotée par des systèmes de consommation intelligents autonomes ?
Plus qu’une volonté de contrôle total des technologies qui freine l’innovation, c’est peut-être notre propre autonomie qu’il convient de repenser à l’aune de l’émergence de ces systèmes. Il s’agit alors de construire, selon la perspective des « technologies de soi » de Foucault (1988), des pratiques par lesquelles l’individu œuvre à sa propre transformation et à son émancipation des diverses formes de domination algorithmique.
Cet article est publié en partenariat avec le média The Conversation dans le cadre des Dauphine Digital Days.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
- Bettman, J. R., Luce, M. F., & Payne, J. W. (1998). Constructive consumer choice processes. Journal of Consumer Research, 25(3), 187–217.
- Ferber, J. (1997). Les systèmes multi-agents : Vers une intelligence collective. Paris : InterÉditions.
- Foucault, M. (1988). Technologies of the self. In L. H. Martin, H. Gutman, & P. H. Hutton (Eds.), Technologies of the self: A seminar with Michel Foucault (pp. 16–49). Amherst: University of Massachusetts Press.
- Franklin, S., & Graesser, A. (1996). Is it an agent, or just a program? A taxonomy for autonomous agents. In Proceedings of the Third International Workshop on Agent Theories, Architectures, and Languages. Berlin: Springer-Verlag.
- Husairi, M. A., & Rossi, P. (2024). Delegation of purchasing tasks to AI: The role of perceived choice and decision autonomy. Decision Support Systems, 179, 114166.
- Jordan, J. M. (2024). The rise of the algorithms: How YouTube and TikTok conquered the world. [Google Books].
- Pariser, E. (2011). The filter bubble: What the Internet is hiding from you. New York: Penguin Press.
- Stephen, A. (2017). Here comes the hyper-connected augmented consumer. NIM Marketing Intelligence Review, 9, 10–17.
- Thiebaut, C. (2020). AI and consumer autonomy: Between empowerment and manipulation. AI & Society, 35(3), 789–799.
À lire aussi
Spécialiste de physique mathématique, Mathieu Lewin explore les points de bascule entre désordre et organisation au sein du CEREMADE de l’Université...
Dans un monde saturé d’informations, les technologies numériques transforment chaque interaction en ligne en donnée exploitable utilisée pour capter...
Et si l'IA ne se contentait pas de répondre, mais agissait également pour nous ? Des assistants capables d’exécuter des tâches complexes, de...