Dossier | L'entreprise à l'épreuve du XXIe siècle
Décarbonation, simplification, compétitivité : cherchez l’intrus
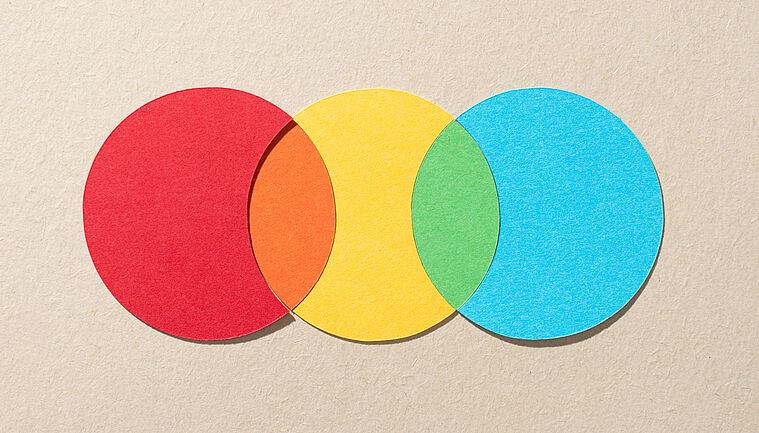
Les régulations environnementales constitueraient un frein à l’économie européenne. Est-ce vrai ? L’exemple du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, grande mesure de politique environnementale de l’UE, fournit un cas d’étude parfait. Derrière les clichés, une vision plus nuancée de la relation entre économie et développement durable.
Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) s’impose aujourd’hui comme l’un des instruments phares de la politique climatique européenne. Conçu pour limiter les fuites de carbone, il protège la compétitivité des industries soumises au système d’échange de quotas (EU ETS)1. Aujourd’hui, le MACF cristallise les tensions liées au vaste chantier de simplification législative engagé par la Commission européenne depuis le début du second mandat d’Ursula von der Leyen.
La question n’est pas seulement juridique ou technique : elle interroge directement la stabilité du cadre d’investissement, la cohérence de la politique industrielle, et le rôle de l’Europe dans la gouvernance climatique internationale. De fait, la réglementation environnementale est souvent présentée comme un frein à la compétitivité des entreprises. Les pays ayant de fortes intentions de protection de l’environnement, comme les états européens, subiraient une concurrence déloyale de la part des pays moins regardants. C’est pour lutter contre ce risque de « havre de pollution », décrit par Levinson et Scott Taylor en 2008, que le MACF a été conçu par la Commission Européenne.
« Le lien entre ambition environnementale et compétitivité n’est pas aussi évident qu’il paraît »
Ainsi, mener des politiques environnementales ambitieuses pèserait trop fort sur notre économie, qui pâtirait d’une concurrence déséquilibrée des pays et régions ne mettant pas en place de telles politiques. L’argument semble imparable : oui, la transition écologique a un coût, elle impose et va imposer des contraintes fortes à de nombreux secteurs, en particulier ceux qui dépendent fortement des énergies fossiles. Ce surcoût pour les entreprises serait en plus transféré sur les consommateurs. Double peine : perte de compétitivité et hausse des prix. Cependant, en y regardant de plus près, on se rend compte que le lien entre ambition environnementale et compétitivité n’est pas aussi évident qu’il en a l’air. D’ailleurs, d’après les nombreuses études sur l’hypothèse de Porter, selon laquelle une réglementation stricte mais bien conçue stimule l’innovation et améliore à terme la compétitivité, on peut conclure qu’il n’existe pas d’opposition systématique entre compétitivité et environnement. Tout dépend de l’architecture des politiques publiques. En particulier, une transition verte réussie nécessite des politiques qui soient justes, ciblées et progressives.
Carbone et compétitivité : un équilibre moins fragile qu’il n’y paraît
La littérature économique sur l’EU ETS fournit un point de départ essentiel. Les travaux empiriques menés au niveau des entreprises montrent que les effets du marché du carbone sur la compétitivité ont été limités. Martin, Muûls, de Preux et Wagner (2014) soulignent que l’EU ETS n’a pas entraîné de pertes massives de parts de marché ou d’emploi, surtout grâce aux allocations gratuites. Dechezleprêtre et Sato (2017) confirment, dans une revue de littérature, que les effets négatifs sont bien moindres que prévu. Ces résultats justifient l’idée que la tarification du carbone peut être compatible avec une compétitivité préservée, à condition que les instruments soient bien conçus.
Les évaluations ex ante du MACF vont dans le même sens. Les modèles d’équilibre général et les analyses multirégionales montrent que l’instrument réduit les fuites de carbone et améliore la position relative des producteurs européens. Bellora et Fontagné (2022) démontrent que les effets dépendent fortement de la structure des importations sectorielles, tandis que Böhringer, Carbone et Rutherford (2018) insistent sur l’importance du design, notamment la couverture sectorielle et le traitement des exportations. Un working paper de l'OCDE en 2025 a mis en avant les répercussions le long des chaînes de valeur : l’incidence du MACF n’est pas uniforme, mais dépend de la capacité à répercuter les coûts et de l’intensité carbone des intrants.
Un point particulièrement sensible est l’asymétrie entre importations et exportations. Le MACF s’applique aux importations mais ne prévoit pas de remboursement de quotas pour les exportations, afin d’éviter un contentieux à l’OMC. Cette absence de symétrie crée un risque pour les secteurs tournés vers l’international, comme l’acier ou l’aluminium. Les analyses juridiques (Leonelli, 2023) rappellent que des rabais à l’export pourraient être considérés comme une subvention déguisée. Ce compromis fragilise néanmoins la compétitivité externe et illustre le dilemme entre le respect des règles commerciales et le soutien industriel.
Une thèse réalisée au sein de la Chaire Economie du Climat met en évidence que la rentabilité des firmes européennes n’est pas impactée négativement par le marché du carbone européen. Pendant les premières années du marché (2005-2012), cette absence d’impact pouvait s’expliquer par la distribution gratuite des permis à polluer aux entreprises et le surplus de ces permis sur le marché, qui a permis de ne pas trop charger les coûts carbone dans la production. Par la suite, la Commission Européenne a pris des mesures pour renforcer l’efficacité du marché des quotas à polluer, notamment en diminuant l’offre globale des permis. Mais malgré cela, nous avons aussi montré que la performance économique des entreprises soumises au marché n’a pas été impactée négativement par leur choix de se décarboner, entre 2012 et 2020.
La simplification, quel rôle dans la transition environnementale ?
La littérature converge finalement sur trois enseignements. Premièrement, les expériences passées montrent que la tarification carbone n’est pas incompatible avec la compétitivité, à condition d’un accompagnement ciblé. Deuxièmement, le MACF améliore la position des producteurs européens mais crée des effets redistributifs importants le long des chaînes de valeur, et laisse en suspens le traitement des exportations. Troisièmement, les effets dynamiques à long terme – innovation, transformation industrielle, recomposition des échanges – demeurent incertains et nécessitent un cadre réglementaire stable. C’est là que le lien avec la « simplification » devient critique : une stratégie pensée pour réduire la complexité pourrait, si elle se traduit par une instabilité permanente, miner la crédibilité économique de l’Union.
« La tarification carbone n’est pas incompatible avec la compétitivité »
Au-delà de la compétitivité immédiate, les enjeux sont budgétaires et stratégiques. Le MACF doit générer des recettes significatives, initialement envisagées comme ressource propre de l’UE. Ces fonds pourraient financer la transition ou alléger la charge budgétaire des États membres. Mais si le dispositif est fragilisé par des révisions incessantes, sa crédibilité comme source de financement et comme instrument de politique industrielle en sera réduite. En outre, les partenaires commerciaux, en particulier les économies émergentes, perçoivent le MACF comme un signal de durcissement. Cosbey et al. (2019) soulignent que les pays à forte intensité carbone seront les plus touchés, ce qui pose des questions d’équité et de coopération internationale. Le risque de tensions commerciales est réel si l’UE ne parvient pas à convaincre que l’instrument vise avant tout la décarbonation globale.
À l’heure actuelle, de fortes pressions se font sentir pour diluer les efforts de lutte contre le changement climatique et de réduction des usages des énergies fossiles. Le commerce international est également chahuté par les guerres commerciales entre les grands acteurs de l’économie globalisée. Dans ce contexte, réduire la voilure d’une politique qui vise à la fois la préservation de l’environnement et le soutien à une compétition commerciale équitable nous paraît être une mauvaise piste sur laquelle la Commission européenne serait avisée de ne pas s’engager. Il conviendrait au contraire qu’elle mette concrètement en œuvre l’extension du MACF à d’autres secteurs, dont la compétitivité est à risque. Par ailleurs, au-delà des secteurs couverts par le marché du carbone, il s’agit des activités économiques plus en aval des chaînes de valeurs où le problème des fuites de carbone se pose. Tel pourrait être le cas du secteur automobile. Voilà pourquoi il ne faut pas que la simplification devienne l’intrus parmi la décarbonation et la compétitivité.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
L’EU ETS (European Union Emissions Trading System), lancé en 2005, fonctionne sur le principe du cap-and-trade, en fixant un plafond global d’émissions de gaz à effet de serre et en distribuant des quotas échangeables entre installations industrielles et producteurs d’électricité. Couvrant environ 40 % des émissions de carbone de l’UE, il a été renforcé par plusieurs réformes successives, notamment pour réduire la volatilité des prix et accélérer la trajectoire de décarbonation. La base juridique actuelle est le Règlement (UE) 2018/410 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union.
À lire aussi
Les réseaux sociaux ont profondément transformé la finance. Ils donnent un pouvoir inédit aux récits, aux émotions et à l’influence. Un post peut...
En permettant de « consommer » son patrimoine sans renoncer à son toit, le viager pourrait être un outil majeur de rééquilibrage social et...
FRANCE CULTURE | La taxe Zucman, qui propose de taxer de 2 % les foyers ayant un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, continue de faire débat....






