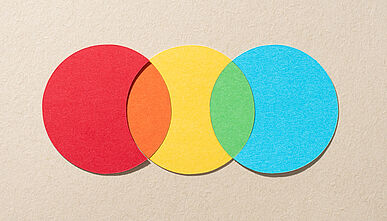Transition Écologique & Sociale
Dossier | L'entreprise à l'épreuve du XXIe siècle
Entre régulation et compétitivité, comment engager les entreprises dans la transition écologique et sociale ?

Hier fer de lance du droit européen, les régulations sociales et environnementales des entreprises sont aujourd’hui menacées. Pressions géopolitiques et impératifs de compétitivité font craindre un retour en arrière. Comment trouver le juste équilibre entre économie et durabilité ? Quelle place pour l’engagement des entreprises dans cette équation ?
La perception du rôle et de la fonction des entreprises à l’égard de la société dans son ensemble a fortement évolué au cours du temps. Dans les années 1970, dans le courant de l’opinion portée par Milton Friedman selon laquelle l’entreprise a pour fonction de maximiser le profit des actionnaires, la théorie de l’agence a permis d’aligner l’intérêt des dirigeants sur celui des actionnaires. En conséquence, les décisions sociales étaient guidées par la seule recherche du profit, au détriment des différents impacts des activités des entreprises.
La prise de conscience à partir des années 2000 du caractère majeur des défis environnementaux et sociaux qui s’offrent à nous a conduit à « prendre au sérieux la responsabilité des entreprises » dans l’adaptation à ces défis (A. Supiot, Prendre la responsabilité au sérieux, ). Kofi Annan avait en ce sens lancé, en 1999 lors du forum économique de Davos, un appel à un pacte de partage de valeurs et de principes entre les entreprises et les Nations Unies. L’objectif était de « donner un visage humain au capitalisme ». Cet appel donnera lieu à la création du Pacte mondial des Nations unies (UN Global Compact), une initiative dédiée à convaincre les entreprises de s’engager dans des pratiques plus responsables.
Au tournant du nouveau millénaire, les régulations juridiques ont été mobilisées pour progressivement orienter les entreprises à prendre en considération les impacts de leurs activités en matière de droits humains et de protection de l’environnement. Dépassant les approches paternalistes qui s’étaient développées au XIXe siècle, cette prise de conscience est d’autant plus nécessaire que certaines entreprises multinationales opèrent dans de nombreuses régions du monde où les législations nationales sont très faibles. La mondialisation des chaines de valeur, s’étirant sur plusieurs continents, ajoute également un argument à la prise en compte des impacts globaux de l’activité.
Obliger les entreprises à rendre compte et à anticiper
Cette structuration a pris appui sur deux mécanismes de nature différente, une obligation de transparence qui incite les entreprises à mieux intégrer ces enjeux, et une obligation substantielle de vigilance qui impose une anticipation et une priorisation des risques liés à ces enjeux. L’obligation de transparence a pris la forme d’une obligation de reporting sur les sujets sociaux et environnementaux : il s’agissait de faire du reporting extra-financier l’égal du reporting financier utilisé par les investisseurs pour mener leurs arbitrages d’investissements. Précurseur par la loi Nouvelles régulations économiques de 2001, l’État a instauré une telle obligation à la charge de toutes les entreprises cotées.
À l’instar de la France, l’Union européenne a adopté en 2014 une directive relative au reporting extra-financier. Cependant, il est apparu nécessaire d’aller plus loin en améliorant la comparabilité entre les informations non financières délivrées par toutes les entreprises, et en renforçant leur fiabilité par un approfondissement du contrôle exercé. C’était toute l’ambition de la directive européenne Corporate sustainability reporting (CSRD) adoptée en décembre 2022, qui a étendu considérablement le champ des entreprises concernées afin de faire du reporting de durabilité, nouveau vocable retenu, le véritable alter ego du reporting financier. Sans doute eut-il été opportun de se rappeler que le mieux est l’ennemi du bien : cette directive a poussé l’exercice de reporting dans un tel raffinement, exigeant un important nombre de points d’informations (1 150 points environ), qu’elle a prêté le flanc à de nombreuses critiques, fondées pour certaines.
L’obligation de vigilance est née en France d’une loi suscitée par le drame du Rana Plaza, l’effondrement d’un immeuble abritant des ateliers de confection au Bengladesh qui a provoqué le décès de 1 100 ouvrières — les décombres étant jonchés d’étiquettes d’entreprises européennes dont certaines françaises. Cet évènement provoqua une forte prise de conscience : les entreprises ne pouvaient détourner le regard sur la manière dont sont fabriqués à l’autre bout du monde les produits et services qu’elles vendent ; un impératif de responsabilisation voyait le jour.
Le devoir de vigilance instauré par la loi française de 2017 est novateur en ce qu’il impose aux entreprises de s’interroger sur les risques suscités en matière de droits humains et de protection de l’environnement. Ces risques devront être identifiés dans un plan de vigilance qui adresse également les mesures permettant de prévenir leur réalisation. Novateur aussi en ce qu’il oblige les entreprises à porter leur regard au-delà de leurs limites, sur toute la chaine d’approvisionnement à travers l’influence qu’elles exercent du fait de leur poids économique sur toutes leurs filiales, sous-traitants et fournisseurs avec qui elles interagissent. Novateur enfin à travers la plasticité qui est sienne, le standard de comportement s’adaptant au fil du temps à tous les nouveaux défis sociétaux et environnementaux, comme par exemple le sujet du plastique. La Commission européenne a puisé dans la loi française une source d’inspiration, d’autant que cette obligation de vigilance s’inscrivait alors parfaitement dans les objectifs du green deal : après bien de rebondissements, la directive CS3D a été adoptée en juin 2024.
Ces obligations de transparence et de vigilance peuvent être un formidable levier pour promouvoir l’engagement des entreprises face aux enjeux sociaux et environnementaux. Tout en favorisant une représentation du succès qui valorise les entreprises les plus engagées, elles les obligent à déployer une vision stratégique sur leurs risques et opportunités de transition de leurs activités (Rapport L’entreprise engagée face aux défis du XXIe siècle, Le Club des juristes, direction I. Kocher de Leyritz, rapporteurs B. Parance et A. Stévignon, nov 2024). Pourtant, des vents contraires se sont levés…
Backlash au nom de la compétitivité économique
Nous assistons aujourd’hui à un fort mouvement de recul de ces régulations, au nom de la compétitivité économique, nouveau mantra de la Commission européenne, qui vient justifier le détricotage de l’ouvrage patiemment tissé. La nouvelle majorité politique européenne issue des élections du Parlement au printemps 2024 a été une des premières causes de ce mouvement de backlash, les partis populistes présentant avec constance les régulations environnementales comme des contraintes bureaucratiques sans fondement. Dans un deuxième temps, le rapport “The future of European competitiveness ‒ A competitiveness strategy for Europe” coordonné par Mario Draghi en septembre 2024 a mis sur la table de l’Union européenne le sujet de la simplification. Enfin, les profondes transformations de l’environnement géopolitique avec l’accession au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump ont parachevé d’entretenir la croyance que les régulations européennes, frein majeur pour les entreprises, devaient être remises en cause.
« Les enjeux climatiques sont des questions juridiques : ils touchent aux droits humains »
Il en résulta la présentation par la Commission européenne en février 2025 d’une proposition de directive omnibus ayant pour objectif de retarder et de réduire la teneur des directives CSRD et CS3D. Sans entrer dans le détail de ses dispositions qui ne sont pas encore définitivement adoptées, retenons pour l’essentiel que la directive omnibus tend à réduire très fortement le champ des entreprises soumises à de telles réglementations, et qu’elle entend alléger les obligations qui en résultent. Ce positionnement va à contre-courant de l’accroissement des risques contentieux sur ces sujets à l’heure où des juridictions internationales ont récemment affirmé la dimension juridique des enjeux climatiques, susceptibles ainsi de fonder des actions en responsabilité tant à l’égard des acteurs étatiques que des acteurs privés. En ce sens, la Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision d’avril 2024 contre la Suisse, et la Cour de justice internationale dans un avis de juillet 2025, ont reconnu que les enjeux climatiques sont des questions juridiques en ce qu’ils touchent les conditions même de l’habitabilité de la Terre, et donc les droits humains. Il en résulte que la responsabilité des acteurs économiques qui participent à l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre pourrait être retenue. C’est pourquoi les entreprises ne peuvent se détourner des impacts de leur activités sur le climat et l’ensemble des sujets sociaux dans leurs ensemble, et il doit être recherché un juste équilibre entre le poids des régulations et la compétitivité qui ne sont opposées qu’en apparence.
Régulation et compétitivité : la recherche d’un juste équilibre
Beaucoup d’entreprises qui ont réalisé pour la première fois leur rapport de durabilité dans le cadre de la CSRD ont salué les vertus de l’exercice et n’entendent pas faire marche arrière. Certes, ces directives ont pu aller trop loin dans certaines exigences, et on ne peut que saluer le fait que le groupe technique qui travaille à l’élaboration des éléments de reporting (l’EFRAG) vienne de rendre public une proposition de réduction des points d’information de moitié. De même, l’attention a été portée sur les PME et ETI qui ne peuvent consacrer trop de moyens financiers et humains à ces règlementations, ce que permet la mise en œuvre d’un principe de proportionnalité.
Mais pour l’essentiel, une majorité d’entreprises apprécient que la mise en œuvre de la CSRD leur a permis de renforcer leur vision stratégique et de mieux intégrer les risques, et qu’elle offre une garantie de transparence et de comparabilité des rapports de durabilité des entreprises (Etude WeareEurope et HEC, mai 2025). Dans le même sens, la BCE (banque centrale européenne) met en garde contre un abaissement des normes en soulignant que le système financier a besoin de données climatiques des entreprises de qualité et de quantité suffisante (Lettre de Christine Lagarde, présidente de la BCE au Parlement européen, 15 août 2025). Dans ce contexte politique hautement instable, la transformation des entreprises repose en définitive beaucoup sur leurs épaules et sur le leadership de leurs dirigeants, ce qui explique qu’on identifie des positionnements très différents.
En outre, affirmer que les régulations européennes sont un facteur de distorsion de concurrence pour les entreprises européennes sonne faux dans la mesure où l’Union européenne avait enfin eu le courage d’imposer ses réglementations aux entreprises étrangères qui opèrent sur son territoire, à l’instar de ce que pratique depuis très longtemps les États-Unis dans l’application extraterritoriale de leur droit sans cesse décriée. Tant la directive CSRD que la CS3D sont applicables aux entreprises étrangères réalisant un chiffre d’affaires conséquent sur le sol européen, tandis que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières est en train de se consolider.
Au-delà de ces considérations relativement techniques, c’est une opposition idéologique qui transparait des débats enflammés sur le sujet dans un contexte géopolitique très incertain sous l’influence américaine. L’Europe souhaite-t-elle encore proposer un modèle de développement fondé sur le respect de l’environnement et la préservation des droits humains, ou entend-elle s’effacer face au diktat posé par Donald Trump qui réfute catégoriquement ces règlementations qui ne sauraient à ses yeux s’appliquer aux entreprises américaines ? Espérons que les convictions des entreprises les plus engagées ne vacillent pas face au mouvement temporaire de backlash.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
À lire aussi
Chaque aliment, chaque vêtement, chaque service repose sur des volumes d’eau considérables, prélevés loin des lieux de consommation. Ces flux d’eau...
Les efforts pour limiter les antibiotiques en élevage se multiplient, mais le modèle industriel persiste. La question de fond est rarement abordée :...

Transition Écologique & Sociale
50 nuances de vert : les négociations de la transition sociale et écologique en entreprise
Synthèse de l’intervention de Camille Dupuy lors de la soirée de lancement du Cercle Travail en transitions, le 5 février 2025, à l’Université Paris...