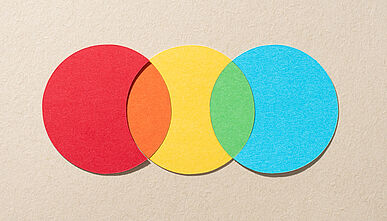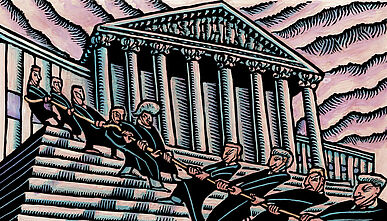Dossier | L'entreprise à l'épreuve du XXIe siècle
Devoir de vigilance et gestion des impacts : où en est vraiment la responsabilisation des entreprises ?

Huit ans après la loi française sur le devoir de vigilance des entreprises, et à l’heure de la directive européenne CS3D, le bilan est contrasté. Si les avancées juridiques sont réelles, les contentieux demeurent rares. Décryptage des ressorts judiciaires et institutionnels qui redessinent les contours de la responsabilité des entreprises.
L’adoption définitive, au terme d’un processus de négociations particulièrement long et difficile, de la Directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) le 24 mai 2024 a constitué une étape importante dans la construction de la responsabilité des sociétés commerciales. Appelée à être transposée en projet de loi par chacun des 27 pays membres de l’Union européenne, mais aujourd'hui âprement remise en cause, cette directive dite “CS3D” exige des entreprises1 qu'elles mettent en place un processus complet d'identification, d'évaluation et de gestion des incidences négatives sur les droits de l'homme et l'environnement. Ce processus doit couvrir non seulement les activités propres de l'entreprise, mais aussi celles de ses filiales et de sa chaîne d'activités, tant en amont qu'en aval.
Concrètement, les entreprises devront cartographier leurs chaînes d'activités, évaluer les risques, mettre en œuvre des mesures préventives et correctives, établir des procédures de plainte et de notification, et communiquer publiquement sur leurs actions. Outre un contrôle par des autorités administratives nationales susceptibles d'émettre des injonctions et d'imposer des sanctions (notamment des amendes), la Directive prévoit un mécanisme de contrôle civil. Aux termes du texte, « lorsque les entreprises, intentionnellement ou par négligence, ne respectent pas leur obligation de prévenir, d’atténuer, de supprimer ou de réduire au minimum les incidences négatives, et, qu’à la suite d’un tel manquement, un dommage a été causé, elles peuvent être tenues pour responsables des dommages occasionnés » ; et, partant, « si l’entreprise est responsable, la victime du préjudice subi aura droit à une réparation intégrale. »

Lire aussi :
Pourquoi et comment démocratiser l’entreprise ?
Cette démarche de juridicisation de la responsabilité de sociétés-mères pour les dommages causés par ses filiales ou partenaires commerciaux n’est pas une première. Elle fait suite à plusieurs initiatives nationales, à commencer par la Loi française sur le Devoir de vigilance adoptée le 27 mars 2017. Celle-ci a marqué un tournant majeur dans le régime de responsabilité des sociétés commerciales. Cette loi prévoit en effet l’obligation, pour toutes les sociétés françaises dépassant un certain seuil de salariés, d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance propre à identifier et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et l’environnement dans l’ensemble de leur chaîne de valeur. Cela a ouvert la voie à deux types d’actions en justice : une société donneuse d’ordre peut être enjointe d’adopter un plan de vigilance conforme à la loi ; elle peut également être amenée à répondre des préjudices que la mise en œuvre d’un plan de vigilance effectif aurait permis d’éviter.
La loi est là, mais où sont les actions en justice ?
Depuis l’adoption de cette loi, force est toutefois de constater que la chronique judiciaire a de quoi rester sur sa faim. En huit ans, pas plus de quinze actions en justice ont été introduites, une seule se traduisant par une audience et décision au fond. En 2015, les débats parlementaires autour de la proposition de loi avaient pourtant été le lieu de plusieurs mises en garde contre la création d’un fort risque contentieux pour les entreprises. Philippe Houillon, co-rapporteur sur la mise en application de la loi proposée, alertait : « Un contentieux nombreux est fort à craindre et en réalité les entreprises seront très exposées à l’appréciation du juge. »2 Cette mise en garde sur un risque de contentieux abondant se doublait d’ailleurs parfois d’une mise en garde sur un risque de contentieux abusif : « On ne peut ignorer, dans cette hypothèse, le risque que soient engagées des actions de nature médiatique » signalait en ce sens le rapport du sénateur Frassa3.
« Même les organisations les mieux dotées ne peuvent pas démultiplier les actions »
Mais, à ce jour, le constat est sans appel : la loi Vigilance n’a pas donné lieu à un contentieux pléthorique, loin de là. Un magistrat du Tribunal Judiciaire de Paris, faisant le compte, s’en étonnait presque lui-même : « D'ailleurs, je suis un peu étonné que les ONG ou que les syndicats ne s'approprient pas davantage le sujet. Est-ce qu'ils n'ont pas les avocats suffisamment spécialisés sur le sujet ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de matière ? Est-ce que peut-être au contraire les entreprises investissent beaucoup et font beaucoup pour éviter les litiges ? Je ne sais pas, c'est possible aussi. »4
La réponse à son interrogation n’a rien d’évident, et l’on ne se risquera pas à avancer une explication unique au faible nombre d’actions lancées. Un élément se dégage néanmoins, qui apporte un éclairage utile. Dans ce qui s’avère être le « petit monde » des contentieux vigilance (car quelques associations ou syndicats seulement sont à l’origine de la plupart des actions), les dossiers montés ont fait l’objet d’un travail préparatoire considérable (plusieurs mois et plusieurs dizaines de pages). Aucune action lancée ne l’a été à la va-vite, juste pour secouer une entreprise qui n’aurait pas publié de plan par exemple – les associations, qui se sont d’ailleurs concertées sur ce point, ont jugé que cela risquerait d’être contreproductif. Les choses changeront peut-être si, hors du noyau dur des porteurs de contentieux, des demandeurs isolés décident de se saisir de la loi avec moins de précautions.
Pour l’heure cependant, les dossiers sont étayés, les faits documentés, les raisonnements affutés. Comme le soulignait d’ailleurs la chargée de contentieux d’une ONG, lors d’une conférence à l’université Paris-Panthéon-Assas en juin 2024 : « Pour vous donner un ordre d’idée de l'ampleur du travail que l'on a eu, les dernières conclusions faisaient plus de 200 pages et plusieurs classeurs de pièces ont été transmis aux juges. Et on n’en est qu’à la phase de mise en état. Donc on est dans un contentieux hors normes. » Cela prend du temps et cela a un coût, au moins celui de la rémunération (même modérée) des chargés de contentieux, parfois celui des honoraires (même réduits) des avocats. Et dans ces conditions, même les organisations les mieux dotées ne peuvent pas démultiplier les actions.
Peu d’actions lancées, soit, mais pourquoi si peu de décisions au fond en huit ans ? La réponse ne tient pas seulement à la lenteur bien connue de la machine judiciaire ; elle tient aussi au fait que l’essentiel des étapes suivies par ces dossiers ont relevé d’enjeux de procédure (compétence du tribunal, intérêt à agir des demandeurs, recevabilité de l’action…). Les entreprises ont soulevé un éventail d’exceptions de procédure. Rien d’étonnant à cela pour cette avocate d’ONG qui, en entretien, expliquait sans s’en émouvoir : « Les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, c’est très classique quand on est en défense (…). Là la singularité c’est qu’il n’y a pas de jurisprudence. » Il fallait donc « purger » ces questions de procédure pour pouvoir ensuite en arriver au fond. Cette purge n’avait rien d’anodin comme en avaient pleinement conscience les parties. Cela s’est d’ailleurs traduit par une affluence parfois inhabituelle pour des audiences de mise en état, comme n’ont pas manqué de le soulever certains avocats, à l’instar de celui de TotalEnergies qui, le 15 mai dernier, lançait non sans une pointe d’ironie : « en quelques années que je fais ce métier, je n’ai jamais vu une salle aussi pleine pour un incident de communication ! ».
Lentement mais sûrement : les prémices judiciaires du devoir de vigilance
Dans quelle mesure cette première phase, procédurale mais loin d’être neutre pour autant, a-t-elle contribué à façonner les contours du devoir de vigilance ? Nous retiendrons deux enjeux sur lesquels les ONG ont d’abord tremblé, confrontées à des décisions défavorables, avant d’avoir finalement gain de cause.
Une première séquence, cruciale, a été celle des débats autour du tribunal compétent. En l’espèce, c’est finalement l’arène politique (le pouvoir exécutif, par la voix du Garde des Sceaux, et le pouvoir législatif, par le vote des parlementaires) qui a repris la main pour trancher un différend jurisprudentiel. Il s’en est fallu de peu que le devoir de vigilance ne tombe dans l’escarcelle des juges consulaires, commerçants, chefs d’entreprise ou artisans chargés de trancher les litiges concernant des actes de commerce. La loi donna finalement compétence exclusive au Tribunal Judiciaire de Paris, qui bientôt se doterait même d’une Chambre spécialisée, la 34ème, avant qu’une telle spécialisation ne soit reproduite au sein de la Cour d’appel de Paris elle-même dotée d’une chambre « Contentieux émergent, devoir de vigilance et responsabilité environnementale ».
Un deuxième enjeu, très important, s’est niché dans un débat technique sur la mise en demeure, ce courrier destiné à demander formellement au débiteur de faire face à ses obligations. Dans le cas du devoir de vigilance, la loi prévoit que la mise en demeure est un préalable à toute assignation devant le juge (au moins trois mois plus tard). Plusieurs des actions initiées ont vu leur recevabilité mise en cause en raison de différences des griefs formulés entre la mise en demeure et l’assignation (Total Climat), entre la mise en demeure et le jour du débat (Total Ouganda), ou encore entre le plan ciblé dans la mise en demeure et celui ciblé dans l’assignation (EDF). La défense faisait valoir, derrière l’argument formaliste, une obligation de dialogue avant toute action. Entendu par le juge de première instance dans les affaires Total Climat et EDF, ce raisonnement a ensuite été infirmé en appel. Les ONG pouvaient se réjouir qu’une contrainte supplémentaire ne vienne pas peser (qui plus est a posteriori) sur leurs actions ; et, qu’en l’occurrence, on ne fasse pas peser sur elles l’obligation de dialoguer avec l’entreprise avant de saisir un juge.
Au-delà de ces enjeux de procédure, la première décision rendue au fond, le 5 décembre 2023, a enjoint La Poste à revoir son plan de vigilance (et notamment à préciser sa cartographie des risques) sans toutefois prononcer d’astreinte. Cette décision, alors jugée « équilibrée » par nombre d’observateurs et parties du contentieux, a finalement donné lieu à un appel de la Poste. Cette fois-ci, la question des contours du devoir de vigilance était le cœur du sujet. Cette question n’est pas nouvelle : comme nous l’avions déjà indiqué en 20205, deux visions s’opposent depuis l’adoption de la loi sur ce qu’est un bon plan.
« Face à une loi floue, les magistrats peuvent finir par apprécier la conformité légale à l’aune des actions symboliques mises en place par les entreprises »
D’un côté, un certain nombre d’entreprises revendiquent une approche formelle de la vigilance, à travers des « structures symboliques » mises en place pour attester leur conformité (ce qu’a la suite de Lauren B. Edelman, nous avions appelé « managérialisation »6 de la loi, i.e. la conversion d’une obligation légale en raisonnements et dispositifs gestionnaires). De l’autre côté, les organisations de la société civile restent attachées à une lecture plus substantielle de la loi (ce que, par symétrie, on qualifiera de « causification »7 de la loi , pour signifier que la lecture de la loi ce fait à l’aune de la cause défendue). Se dirige-t-on, aujourd’hui, vers la victoire de la « managérialisation » par le biais de la « déférence judiciaire » aux structures symboliques ? Cette thèse, avancée par L. Edelman à partir de son étude de cas du Titre VII du Civil Rights Act américain de 1964 (visant l’interdiction de la discrimination au travail), consiste à dire que, face à une loi floue, les magistrats peuvent finir par apprécier eux-mêmes la conformité légale des entreprises à l’aune des seules structures formelles mises en place, sans considération de leur (in)efficacité6.
À l’audience d’appel, le 18 mars 2025, l’un des avocats de La Poste – en l’occurrence Bernard Cazeneuve, qui était premier ministre lorsque la loi a été votée – a tenu la ligne de la managérialisation en évoquant l’esprit de la loi. La décrivant, travaux parlementaires à l’appui, comme destinée aux seules entreprises « récalcitrantes », il suggérait un raisonnement plus explicitement lisible dans les dernières conclusions : comment une telle loi pourrait-elle s’abattre sur La Poste, une entreprise de bonne volonté dont « l’engagement et les efforts ont été salués en 2020 et 2021 par l’agence de notation indépendante Vigéo Eiris, qui lui a décerné la première place et la plus haute note jamais attribuée deux années consécutives » ? Comment pourrait-elle s’abattre sur une entreprise qui, en 2024, « a encore progressé dans le classement Ecovadis et a retrouvé le 1er rang mondial tous secteurs confondus en obtenant la meilleure notation jamais attribuée par Moody’s ESG Solutions (81/100) » ?
Par ailleurs, jouant sur le double tableau du processus judiciaire (français) et du processus législatif (européen), l’avocat de La Poste a évoqué la directive Omnibus proposée début 2025 pour « simplifier » la Directive européenne sur la Corporate Sustainablity Due Diligence. Il affirmait ainsi : « la tendance actuelle est à la praticabilité du dispositif ». Dans ces conditions, insistait-il, une interprétation trop exigeante du devoir de vigilance (par rapport à la direction prise par la CS3D) conduirait à pénaliser les entreprises françaises, « ce qui serait quand même, dans le contexte international et européen que nous connaissons, particulièrement préjudiciable ».
Le Devoir de vigilance se limitera-t-il à une forme de juridicisation des politiques de RSE, dans leurs promesses mais aussi dans leurs failles ? Le risque est loin d’être exclu. Pour autant, dans son arrêt rendu le 17 juin 2025, la chambre 5-12 de la Cour d’appel de Paris a confirmé la légitimité d’une appréciation, par le juge, de la qualité de la cartographie des risques. Voilà donc, en 2025, la (double) victoire que peuvent revendiquer les organisations de la société civile. D’abord, la Cour d’appel a réaffirmé l’existence d’une loi française dont l’interprétation, à ce stade, ne doit pas dépendre des voltefaces des négociations européennes. Ensuite, elle a confirmé qu’une entreprise peut se voir enjointe de refaire son plan de vigilance si les juges estiment que celui-ci n’est pas conforme aux exigences légales en raison de son imprécision. Contre vents et marées, le processus de responsabilisation des entreprises continue.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
Dans sa dernière version publiée, le 5 juillet 2024, la CS3D fixe l'obligation de vigilance pour les sociétés de l’UE de plus de 1000 salariés et d’un chiffre d’affaires net mondial supérieur à 450 millions d’euros. Les entreprises des pays tiers sont également concernées dès lors qu’elles atteignent un chiffre d'affaires net supérieur à 450 millions d'euros dans l'UE. De nouvelles délibérations ont toutefois été ouvertes en 2025, prévoyant une révision des seuils à la hausse.
Rapport n° 2628 par Dominique Potier enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 11 mars 2015.
Rapport n° 74 par Christophe-André Frassa enregistré à la Présidence du Sénat le 14 octobre 2015, p. 32.
Cette contribution s’appuie sur une enquête réalisée au cours des quatre dernières années, qui m’a amenée à conduire 56 entretiens avec différents acteurs (chargés de campagne en ONG, avocats, magistrats, auteurs de doctrine…) ayant pris part, à un titre ou à un autre, aux contentieux sur le fondement de la loi Vigilance. Ce verbatim est issu de l’un de ces entretiens.
P. Barraud de Lagerie, É. Béthoux, A. Mias, et É. Penalva Icher (2020). La mise en œuvre du devoir de vigilance : une managérialisation de la loi ? Droit et société, 106(3), 699-714.
L. B. Edelman, (2016). Working Law: Courts, Corporations, and Symbolic Civil Rights, Chicago : University of Chicago Press.
P. Barraud de Lagerie, (2025). La fabrique de la vigilance, Mémoire original d’Habilitation à Diriger des Recherches.
À lire aussi
Santé, biodiversité, agriculture : les pesticides cristallisent les oppositions. Derrière le débat politique, une question centrale demeure : quelles...
La science est intimement liée à la politique depuis la Révolution française. Cette connexion s’est traduite par la production d’experts censés...

Transition Écologique & Sociale
Entre régulation et compétitivité, comment engager les entreprises dans la transition écologique et sociale ?
Hier fer de lance du droit européen, les régulations sociales et environnementales des entreprises sont aujourd’hui menacées. Pressions géopolitiques...