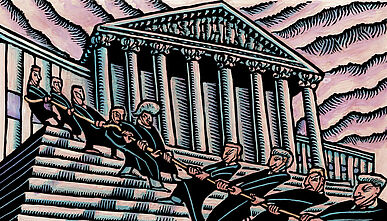Visibilité, polémique et radicalité : comment l’extrême droite impose ses thèmes dans le débat public
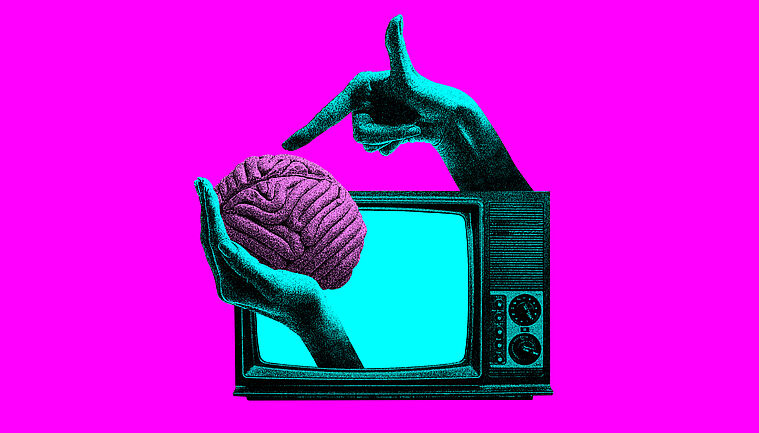
Débats télévisés, réseaux sociaux, provocations : comment des acteurs aux marges du champ politique réussissent à imposer leurs thèmes dans le débat public, et à positionner le Rassemblement national au centre du jeu politique.
Le Rassemblement national ne mène pas seul sa bataille culturelle. Autour de lui gravitent des entrepreneurs d’extrême droite — polémistes, influenceurs, groupuscules — qui s’imposent dans l’espace médiatique en adoptant des stratégies de confrontation spectaculaires. Ce jeu d’alliances indirectes entre sphère politique et monde médiatique constitue un ressort central du succès contemporain de l’extrême droite.
Encore marginale au début des années 2000, cette nébuleuse identitaire regroupe aussi bien des groupuscules militants issus de Génération identitaire ou Némésis, que des influenceurs masculinistes sur les réseaux sociaux, des polémistes de plateau télé ou des essayistes réactionnaires. En 20 ans, elle est parvenue à diffuser ses visions du monde bien au-delà de son propre camp politique. Ainsi, en janvier, le Premier ministre François Bayrou a évoqué un « sentiment de submersion migratoire », quand Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur, a parlé « d’ensauvagement » et Bruno Retailleau, son successeur, de « Français de papier ». Cette sémantique, qui décline plus largement le concept de « grand remplacement » est issue d’une extrême droite radicale, encore marginale au début des années 2000. Comment a-t-elle pu devenir consensuelle, au point d’être repris par le Gouvernement ?
Cette stratégie médiatique, souvent qualifiée de « métapolitique », ne cherche pas à conquérir directement le pouvoir, mais à imposer ses thématiques dans le débat public. Elle tire parti d’un espace médiatique qui valorise le clash, la controverse et l’audience, même au prix d’une marginalité politique assumée. La logique est simple : provoquer pour exister, choquer pour s’imposer, saturer l’espace médiatique pour influencer l’agenda politique . C’est ainsi en jouant sur les ressorts du conflit, de la provocation et du spectaculaire que ces acteurs accèdent à une visibilité disproportionnée par rapport à leur poids électoral.
En marge du champ politique mais au centre de l’espace médiatique
Cette diffusion du lexique identitaire surprend d’autant plus que le mouvement n’a jamais occupé de positions dominantes dans le champ politique : par exemple, les militants du Bloc identitaire, parti politique fondé en 2002, ont toujours obtenu des scores minimes aux élections, y compris locales. Le mouvement ne dispose pas non plus d’un réseau militant actif étendu ni de moyens financiers conséquents. Leur visibilité médiatique ne découle donc pas directement, comme c’est souvent le cas, d’un capital politique préexistant et leur popularité ne suit donc pas le schéma le plus habituel en politique.
Dans la plupart des cas, les invités politiques sont invités à la télévision parce qu’ils sont déjà des acteurs politiques consacrés. Leur parole médiatique est une extension de leur légitimité politique. Pour la plupart d’entre eux, parler aux journalistes est un exercice routinisé, lié aux pouvoirs qu’ils détiennent et qui leur confère une écoute indépendamment des efforts qu’ils mettent en œuvre pour valoriser leur image auprès du public. Autrement dit, plus on se rapproche des régions les plus dominantes et sélectives de l’espace médiatique et plus le capital médiatique, c’est-à-dire la reconnaissance publique que l’on acquiert à partir de sa présence dans les médias, est en fait dépendant d’un capital politique accumulé au préalable.

Lire aussi :
Vote RN, « populisme » et démocratie
Il en va autrement de la nébuleuse identitaire. En déclinant essentiellement un cadrage anti-islam, elle formule peu de propositions sur les autres thématiques politiques traditionnelles, notamment en matière d’économie. En cela, elle ne joue pas le rôle d’un parti politique classique, en formulant et en confrontant une série de mesures, condensées dans un programme cohérent. Sa stratégie repose sur d’autres circuits de médiatisation, qui ne sont pas spécifiques au politique : l’agit-prop (agitation et propagande), l’exploitation des paniques morales ou des faits divers. Les identitaires cherchent à politiser l’émotion suscitée par des événements comme les meurtres de Lola (2022), Thomas (2023), ou encore Philippine (2024), qu’ils présentent comme des signes d’une agression musulmane contre les « Français de souche ».
Priorité à la visibilité médiatique plutôt qu’à l’autorité politique
Sur les plateaux de télévision, dans les talk-shows, ou sur les réseaux sociaux, certains acteurs d’extrême droite multiplient les interventions provocatrices. Ils y mobilisent des codes empruntés au divertissement : clashs, slogans chocs, indignation théâtralisée. Cette posture leur permet de capter l’attention, condition essentielle de leur visibilité. Leurs prises de parole sont souvent moins destinées à convaincre qu’à polariser : l’objectif est de créer un clivage, de susciter des réactions, quitte à être critiqués. Dans un espace médiatique dominé par les logiques d’audience, la transgression devient un atout stratégique.
Cette logique du « buzz » est pleinement assumée : les identitaires cherchent à provoquer, à créer la polémique, à faire réagir, même négativement. La valeur d’une action ou d’une déclaration se mesure surtout à sa viralité, mesurée en nombre de vues sur les réseaux sociaux, ainsi qu’à sa reprise dans les journaux. Les mouvements minoritaires ont besoin que leur voix soit amplifiée pour qu’elle résonne dans l’espace médiatique. C’est tout l’enjeu de provoquer une tension avec les acteurs politiques et médiatiques plus dominants qu’eux, parce qu'ils sont les seuls à pouvoir leur fournir la visibilité dont ils ont besoin pour populariser leurs idées.
Pour eux, la visibilité médiatique prime sur la légitimité politique
Mes propres observations montrent que les identitaires ne considèrent pas les réactions négatives des journalistes et des opposants politiques comme un problème. Au contraire, les cadres militants, pour certains d’entre eux professionnels de la communication politique, placent délibérément ce qu’ils appellent le « buzz », c’est-à-dire la visibilité, au cœur de leur stratégie politique. À choisir, pour eux, la visibilité médiatique prime sur la légitimité politique. C’est pourquoi toute action, souvent à la limite de la légalité, doit pour faire réagir les adversaires politiques, comporter une part de radicalité, de transgression et de provocation. Ce n’est pourtant pas la première fois que des outsiders politiques usent de cette stratégie. Jean-Marie Le Pen avait notamment l’habitude de « petites phrases » destinées à susciter l’indignation de ses adversaires, ce qui contribuait à façonner la représentation d’un « outsider » et à renforcer son image de candidat « antisystème ».
La difficile conversion du capital médiatique en capital politique
Le cas des « buzz » produits par les identitaires traduit l’émergence d’un nouveau circuit possible de légitimation politique qui a quelques points communs avec celui dans lequel s’est engagé Donald Trump aux Etats-Unis, ou Éric Zemmour en France. Avant de briguer des mandats électifs, ces derniers sont d’abord devenus des célébrités médiatiques controversées, c’est-à-dire suscitant autant l’adhésion que la détestation. Donald Trump s’est fait connaître par ses affaires dans l’immobilier de luxe, son rôle dans l’organisation de concours de beauté comme Miss Univers, puis sa participation à une émission de télé réalité. Éric Zemmour, quant à lui, est devenu une figure récurrente des talk-shows télévisés, d’abord sur France 2, puis sur CNews, tout en publiant plusieurs best-sellers à tonalité réactionnaire.
Tous deux ont appris à s’ajuster à des formats médiatiques qui valorisent la provocation et la polémique. Cette posture, efficace pour accumuler rapidement du capital médiatique, n’est pas sans risque : elle repose sur des clivages forts qui peuvent fragiliser leur crédibilité politique, en particulier lorsqu’il s’agit de rassembler au-delà de leur base militante. On aurait d’ailleurs pu s’attendre à ce qu’ils adoptent une posture plus consensuelle au moment d’entrer en politique, afin de séduire un électorat plus large. C’est pourtant l’inverse qui s’est produit. À l’image des identitaires, Trump et Zemmour ont choisi d’accentuer les clivages, en multipliant provocations et attaques contre leurs adversaires, forçant ainsi le public à se positionner « pour » ou « contre » eux. Autrement dit, ils ont transposé dans l’arène politique les compétences acquises dans l’univers médiatique.
Trump a alors pu s’appuyer sur des médias comme Fox News, qui lui ont offert une tribune continue, sans qu’il ait besoin de passer par les canaux plus traditionnels du débat politique. En France, Éric Zemmour a bénéficié du soutien du groupe médiatique de Vincent Bolloré (Canal+, CNews, etc.), qui lui a offert une exposition quotidienne à une heure de grande écoute.
La nébuleuse identitaire contribue à cadrer les problème publics en influençant la perception
Si l’on comprend assez bien comment ces stratégies clivantes permettent de gagner en visibilité, il est en revanche plus complexe d’analyser les conditions qui permettent de transformer ce capital médiatique en capital politique, autrement dit, en crédibilité et en influence électorale. Cette visibilité rapide, souvent obtenue par des prises de position radicales, rend leurs auteurs vulnérables. Les militants de Génération identitaire, par exemple, ont été poursuivis à plusieurs reprises devant la justice pour leurs actions spectaculaires – comme l’occupation du toit de la mosquée de Poitiers ou l’intrusion dans les locaux de l’ONG SOS Méditerranée – et leur groupe a finalement été dissous en 2021.
Aussi, les ressources médiatiques qui ont permis un temps à Zemmour d’occuper l’espace médiatique - la radicalité, la transgression, la polémique, etc. - lui ont été reprochées dans un second temps par ses adversaires politiques et par les médias traditionnels lorsqu’il a dû confronter son programme politique. Dans ces cas, le passage du rôle de provocateur médiatique à celui d’acteur politique dépend de plusieurs conditions : des soutiens financiers durables, des cadres juridiques favorables, et surtout un environnement médiatique propice.
Une alliance à distance pour installer le RN dans sa zone de confort
Au fond, il est assez peu probable que la mouvance identitaire parvienne à s’imposer durablement comme un acteur politique légitime en misant uniquement sur la visibilité médiatique. Mais cela ne signifie pas qu’elle est sans influence. En réalité, elle joue un rôle central dans la transformation de l’espace médiatique et politique, en créant un environnement favorable à l’essor du Rassemblement national.
C’est ce que vise la stratégie que cette nébuleuse identitaire qualifie elle-même de « métapolitique » : non pas conquérir immédiatement le pouvoir, mais façonner les idées et les perceptions en amont, dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et cette stratégie fonctionne d’autant mieux qu’elle cible des espaces particulièrement sensibles à la logique de l’audience : talk-shows, formats courts viraux, débats télévisés, plateformes sociales. Ces espaces brouillent souvent les frontières entre information, opinion et divertissement, ce qui rend plus difficile toute mise à distance critique.
Ainsi, la nébuleuse identitaire contribue puissamment à cadrer les problèmes publics, en influençant la manière dont certains faits sont perçus, interprétés et présentés comme des enjeux prioritaires dans le débat public. Pour le RN, cette activité est une véritable aubaine. Elle alimente un imaginaire politique fondé sur l’idée d’un « ordre à rétablir », en désignant certains groupes – immigrés, musulmans, militants progressistes – comme des menaces à éliminer ou à neutraliser. Les discours identitaires mettent ainsi en scène une société en péril, qu’il faudrait protéger en restreignant les libertés, en fermant les frontières ou en renforçant l’autorité.
Ce diagnostic médiatique rencontre les propositions politiques du RN, qui peut alors apparaître comme une réponse « raisonnable » à une situation présentée comme alarmante. Ce jeu d’alignement stratégique est d’autant plus efficace que les identitaires restent formellement extérieurs aux partis. Ils ne parlent pas au nom du RN, mais leur influence pousse l’ensemble des acteurs politiques à se positionner face aux thèmes qu’ils ont imposés dans l’agenda médiatique : insécurité, immigration, déclin national, etc.
La droite classique, voire certaines personnalités de la gauche, peuvent alors être tentées de reprendre ces cadrages ou ces éléments de langage, dans l’espoir d’attirer un électorat séduit par la radicalité du discours identitaire. Autrement dit, la radicalité des marges sert de boussole, et tire vers la droite tout le débat public.
Cette configuration illustre un phénomène d’alliance à distance. Les acteurs n’ont pas besoin de coordination formelle pour converger. Leurs stratégies s’articulent parce qu’elles répondent à des intérêts complémentaires dans des champs distincts : gagner en visibilité, déplacer le centre de gravité du débat, capter une audience ou un électorat.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
Ressources complémentaires :
- Samuel Bouron, Politiser la haine. La bataille culturelle de l’extrême droite identitaire, Paris, La Dispute, 2025.
- Samuel Bouron et Ugo Palheta « Identitaires. Comment les médias dominants font le jeu d’une mouvance néofasciste », Podcast Minuit dans le siècle, 2025.
- Samuel Bouron, « Les faits divers, industrie médiatique et arme idéologique pour l’extrême droite », in Ugo Palheta (dir.), Extrême droite : la résistible ascension, Éditions Amsterdam, 2024.
Extrait disponible sur Acrimed
À lire aussi
Santé, biodiversité, agriculture : les pesticides cristallisent les oppositions. Derrière le débat politique, une question centrale demeure : quelles...
La science est intimement liée à la politique depuis la Révolution française. Cette connexion s’est traduite par la production d’experts censés...

Transition Écologique & Sociale
Entre régulation et compétitivité, comment engager les entreprises dans la transition écologique et sociale ?
Hier fer de lance du droit européen, les régulations sociales et environnementales des entreprises sont aujourd’hui menacées. Pressions géopolitiques...