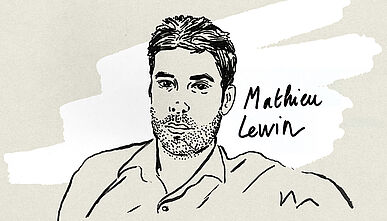Dossier | Chocs géopolitiques : prévenir, tenir, rebondir ?
Les données et les crises : pour le meilleur et pour le pire
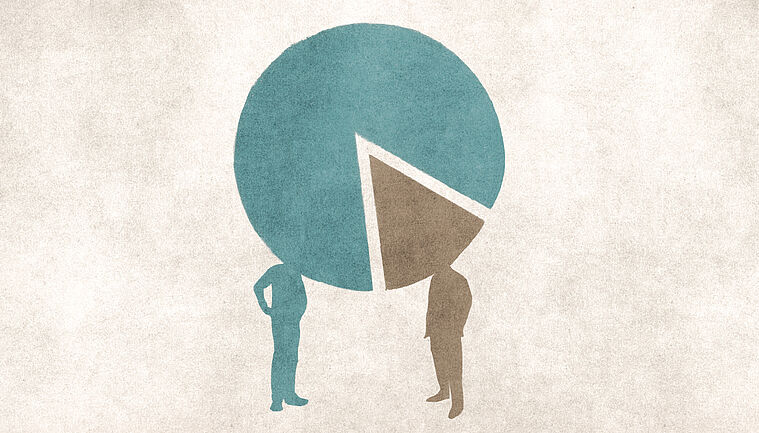
Grâce aux données et aux algorithmes, il devient possible d’anticiper et de gérer les crises en temps réel. Toutefois, ces outils soulèvent aussi des enjeux techniques, éthiques et humains majeurs. Quels sont les écueils à éviter ? Comment exploiter la technologie sans compromettre nos choix collectifs ?
Toutes sortes de données sont aujourd’hui produites et collectées en temps réel. La mobilité de populations peut être suivie via le GPS ou le bornage des téléphones portables aux antennes1. Les satellites produisent des images en continu, par exemple par le système Copernicus permettant de détecter des catastrophes naturelles. Les likes et partages des réseaux sociaux reflètent en temps réel les opinions liées à des évènements2. Enfin, de nombreuses communautés génèrent et échangent des données sur les espaces urbains, comme la communauté OpenStreetMap, ou UAViators.
En situation de crise, toutes ces données deviennent des ressources, à la fois pour les organisations impliquées et pour les citoyens3. L’un des principaux bénéfices du traitement informatique des données réside dans sa capacité à améliorer la détection précoce des chocs, accidents et crises. En exploitant cette masse de données, les algorithmes d’intelligence artificielle permettent d’identifier des schémas anormaux et d’alerter rapidement les autorités compétentes4. Par exemple, dans le domaine de la santé publique, des outils d’analyse prédictive comme HealthMap permettent d’anticiper la propagation d’épidémies en détectant des signaux faibles dans les recherches en ligne ou les ventes de médicaments. Cette rapidité de détection est essentielle pour prévenir et limiter la propagation d’une crise.
Prévenir, répondre, et optimiser en temps réel
Le traitement des données améliore également la prise de décision. Les modèles algorithmiques permettent d’analyser plusieurs scénarios en fonction des informations disponibles et d’optimiser les stratégies d’intervention5. Dans le cadre d’une catastrophe naturelle, certains systèmes proposent des itinéraires d’évacuation en tenant compte en temps réel des embouteillages, des infrastructures endommagées et des conditions météorologiques. C’est notamment le cas de GoogleMap couplé à la suite Google Crisis Response. Cela permet d’éviter des situations chaotiques et d’améliorer l’efficacité des secours.
Un autre atout majeur réside dans l’optimisation des ressources. En situation critique, les moyens disponibles (personnel médical, équipements, approvisionnement en nourriture ou en eau) sont souvent limités. L’IA et l’analyse de données permettent d’optimiser leur allocation en fonction des besoins les plus urgents6. C’est ainsi que lors de la pandémie de COVID-19, certains hôpitaux ont utilisé des algorithmes pour anticiper l’afflux de patients et ajuster leur capacité d’accueil en conséquence. De même, dans une crise humanitaire, l’analyse des flux de réfugiés permet d’anticiper la répartition des aides et d’éviter les pénuries dans certaines régions.
L’apport des données et des algorithmes s’illustre dans la poursuite d’une plus grande résilience des villes, qualifiée alors de smart cities. Grâce aux objets connectés et aux systèmes de surveillance intelligents, les villes peuvent détecter plus rapidement les incidents (accidents industriels, incendies, inondations…) et coordonner une réponse efficace7,8. Le projet FloodCitiSense utilise par exemple un réseau de capteurs pour alerte les autorités en cas de variation anormale du niveau des eaux.
La recommandation intelligente en temps de crise
Aujourd’hui, il est également possible de s’appuyer sur les systèmes de recommandation. Ces systèmes, qui étaient initialement utilisés pour proposer des films, des produits ou des contenus en ligne, trouvent aujourd’hui des applications dans la prévention et la réponse aux crises9. Leur principe repose sur l’exploitation de vastes ensembles de données pour proposer des réponses personnalisées et adaptées à la situation en cours10.
L’une des méthodes les plus courantes est le filtrage collaboratif, qui se base sur l’analyse des comportements et des choix d’utilisateurs similaires, tout comme Netflix suggère des contenus en fonction des films que des utilisateurs aux goûts similaires ont appréciés. Dans le contexte d’une crise, la recommandation peut également s’appuyer sur des décisions prises lors d’événements passés pour suggérer des actions adaptées à la situation actuelle11. Si une ville a déjà mis en place une stratégie efficace d’évacuation lors d’une inondation, elle peut être utilisée pour recommander des actions dans une autre région confrontée à un danger similaire.
Une autre approche repose sur le filtrage basé sur le contenu, où le système analyse les caractéristiques spécifiques d’une situation pour proposer des solutions adaptées. En cas de panne électrique massive, un système de recommandation peut suggérer des stratégies d’intervention en fonction des infrastructures disponibles, du nombre de personnes affectées et des ressources énergétiques alternatives accessibles. Si la crise est une catastrophe naturelle, les données météorologiques et les retours d’expérience des équipes de secours seront pris en compte. Ces recommandations sont générées en croisant les données historiques, les études de cas passées et les contraintes spécifiques à la crise en cours.
Des solutions puissantes, mais pas parfaites
Cependant, malgré de nombreux avantages, le recours aux algorithmes et aux données pour la gestion des crises présente aussi des inconvénients et des défis12.
Les algorithmes d’IA sont souvent attaqués sur leur manque de transparence, et qualifiés de « boîtes noires »13. Pour remédier à cela, des recherches récentes se concentrent sur l’« IA explicable », qui vise à fournir des justifications compréhensibles aux recommandations proposées14. L’IA explicable permet, par exemple, de détailler pourquoi un itinéraire d’évacuation a été privilégié par rapport à un autre, en mettant en avant les paramètres pris en compte : densité de circulation, état des routes, présence de zones inondées, etc.
Outre la question de l’explicabilité, qu’en est-il de la fiabilité ? Les modèles prédictifs reposent sur la qualité des informations qu’ils reçoivent. Or, en période de crise, les données peuvent être incomplètes, imprécises ou biaisées. Lors d’une catastrophe, les infrastructures de communication peuvent être endommagées, rendant difficile la collecte d’informations. Les données, incomplètes ou erronées, peuvent fausser les résultats des algorithmes et entraîner des décisions inefficaces, voire dangereuses, de la part des décideurs.
Un autre enjeu important concerne la cybersécurité. Une intrusion malveillante ou une erreur dans un système de gestion de crise pourrait entraîner des perturbations majeures, allant de la diffusion de fausses alertes à la paralysie des infrastructures critiques. Ce fut par exemple le cas en janvier 2018 : une fausse alerte de missile envoyée à toute la population d'Hawaï, due à une erreur humaine dans le système de gestion des alertes d'urgence, a provoqué une panique généralisée. La sécurisation des données et la mise en place de protocoles robustes sont donc essentielles pour garantir l’intégrité et la fiabilité des systèmes d’alerte et de recommandation.
Combiner intelligence artificielle et intelligence humaine
Les questions éthiques et sociétales constituent également un défi de taille. L’exploitation des données personnelles, notamment dans le domaine de la santé ou de la mobilité, soulève des préoccupations en matière de respect de la vie privée. Par exemple, le cas de Clearview AI, qui a collecté des milliards d'images de visages sans consentement pour alimenter son système de reconnaissance faciale, illustre les préoccupations éthiques et sociétales liées à l'exploitation des données personnelles, notamment en matière de respect de la vie privée. L’utilisation des algorithmes pour surveiller et prédire les comportements peut engendrer des dérives, comme la discrimination algorithmique ou la mise en place de politiques trop intrusives.
Enfin, l’automatisation de la prise de décision par des algorithmes peut entraîner une dépendance excessive aux outils numériques. Si les modèles de prédiction sont extrêmement performants, ils ne remplacent pas l’expertise humaine, notamment lorsqu’une situation imprévue se présente. Une crise est, par définition, un événement complexe et dynamique, où l’intuition, l’expérience et le discernement humain restent indispensables pour adapter la réponse aux circonstances réelles. Pour les professionnels de la gestion de crise, il est donc crucial d’apprendre à utiliser les nouveaux outils à disposition, tout en préservant leur indépendance de décision.
En conclusion, le traitement des données et les algorithmes sont des outils puissants pour anticiper et gérer les crises. Ils améliorent la rapidité de détection, la prise de décision et l’optimisation des ressources. Toutefois, leur efficacité dépend de la qualité des données, de la robustesse des systèmes et du respect des principes éthiques. Pour tirer pleinement parti de ces technologies, il est essentiel de combiner l’intelligence artificielle à l’intelligence humaine15, en développant des solutions hybrides où les algorithmes assistent, mais ne remplacent pas, les experts et les décideurs. L’avenir de la gestion des crises repose donc sur un équilibre entre innovation technologique et vigilance éthique, afin de garantir des réponses efficaces, sécurisées et respectueuses des droits fondamentaux16.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
Meier, P. (2015). Digital Humanitarians: How Big Data Is Changing the Face of Humanitarian Response. CRC Press.
Vieweg, S., Hughes, A. L., Starbird, K., & Palen, L. (2010). Microblogging during two natural hazards events. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 1079-1088.
Zook, M., Graham, M., Shelton, T., & Gorman, S. (2010). Volunteered geographic information and crowdsourcing disaster relief: A case study of the Haitian earthquake. World Medical & Health Policy, 2(2), 7-33.
Imran, M., Castillo, C., Lucas, J., Meier, P., & Vieweg, S. (2015). AIDR: Artificial Intelligence for Disaster Response. Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 159-162.
Benaben, Frédérick & Lauras, Matthieu & Truptil, Sébastien & Salatge, Nicolas. (2016). A Metamodel for Knowledge Management in Crisis Management. 126-135. 10.1109/HICSS.2016.24.
Van de Walle, B., Turoff, M., & Hiltz, S. R. (2016). Information systems for emergency management. Routledge.
Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., Portugali, Y. (2012). Smart cities of the future. The European Physical Journal Special Topics, 214(1), 481-518.
Negre, Elsa & Rosenthal-Sabroux, Camille. (2015). Smart Cities: A salad bowl of Citizens. ICT and Environment. 10.4018/978-1-4666-8282-5.ch004.
Negre E. Systèmes de recommandation - Introduction - ISTE, 2015.
Grolinger, K., Capretz, M. A. M., Mezghani, E., & Exposito, E. (2013). Knowledge as a Service Framework for Disaster Data Management. IEEE Transactions on Cloud Computing, 1(4), 1-12.
Negre E. Systèmes de recommandation : généricité, évaluation et améliorations. Habilitation à Diriger des Recherches. Université de Toulouse, Novembre 2017.
Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. Big Data & Society, 3(2), 1-21.
Zachary C. Lipton. 2018. The Mythos of Model Interpretability: In machine learning, the concept of interpretability is both important and slippery. Queue 16, 3 (May-June 2018), 31–57
Tintarev, N., Masthoff, J. (2015). Explaining Recommendations: Design and Evaluation. In: Ricci, F., Rokach, L., Shapira, B. (eds) Recommender Systems Handbook. Springer, Boston, MA
Abid, S. K., Sulaiman, N., Chan, S. W., Nazir, U., Abid, M., Han, H., ... & Vega-Muñoz, A. (2021). Toward an integrated disaster management approach: how artificial intelligence can boost disaster management. Sustainability, 13(22), 12560.
Visave, J. (2024). AI in Emergency Management: Ethical Considerations and Challenges. Journal of Emergency Management and Disaster Communications, 5(1), 165-183.
À lire aussi
Spécialiste de physique mathématique, Mathieu Lewin explore les points de bascule entre désordre et organisation au sein du CEREMADE de l’Université...
Dans un monde saturé d’informations, les technologies numériques transforment chaque interaction en ligne en donnée exploitable utilisée pour capter...
Et si l'IA ne se contentait pas de répondre, mais agissait également pour nous ? Des assistants capables d’exécuter des tâches complexes, de...