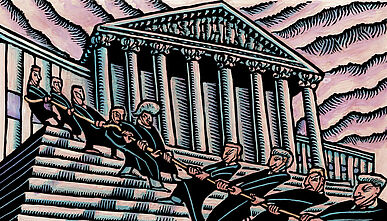Dossier | Chocs géopolitiques : prévenir, tenir, rebondir ?
Résilience à la libanaise : la stabilité malgré les crises

Malgré des décennies de crises, le Liban résiste. La société libanaise s’adapte, s’organise, survit. L’État, quant à lui, peine à se transformer. Alors que le pays veut entrer dans une phase de réforme, cette résilience, aussi fascinante que paradoxale, interroge. Comment un système si fragilisé parvient-il à tenir sans jamais vraiment se transformer ?
Pour l’année 2025, le Liban officiel a décidé de se placer sous le signe de la réforme. Au mois de janvier, la classe politique réussissait enfin à faire élire Joseph Aoun, alors chef de l’armée nationale, à la présidence de la République après une vacance de plus de deux ans1. Dans la foulée, Nawaf Salam, démissionnait de ses fonctions de président de la CIJ pour endosser le rôle de nouveau Premier ministre. Les deux hommes incarnent un duo hautement symbolique. L’un comme l’autre ont, depuis leur prise de poste, formellement exprimé leur engagement en faveur de trois chantiers d’assainissement des institutions et de la vie socioéconomique du pays.
Leur premier objectif est la fin des armes échappant à l’autorité de l’État, dans une allusion claire à l’arsenal du Hezbollah, tenu par de nombreuses parties comme responsable de la guerre israélienne contre le Liban entre septembre et novembre 2024. Deuxième chantier : la lutte contre la corruption et le développement d’une culture d’accountability au sein des institutions. Enfin, le rétablissement de l’économie, dont l’effondrement aussi dramatique que spectaculaire en 2019 avait été qualifié par la Banque mondiale d’« un des trois plus graves blocages du genre depuis la moitié du XIXe siècle ».
“L’antidote est parfois aussi dans le poison, et le sevrage en est d’autant plus difficile.”
Cette volonté de tourner la page intervient après plusieurs décennies de crises multiformes successives. La brutalité de celles-ci a régulièrement autorisé à craindre une faillite autrement plus significative à la fois de l’État et du pacte social libanais. Aussi imparfaite soit-elle, la résilience de la société libanaise est un fait indéniable – et interroge. Comment expliquer la perduration d’un système et d’une culture politiques maintes fois décriés, d’une équipe dirigeante majoritairement conspuée, mais aussi le constat du non-retour à une guerre civile pourtant maintes fois annoncée ?
L’interrogation est d’autant plus pressante que la réforme tant attendue par les Libanais est, en ce début 2025, un pari loin d’être gagné. Une grande partie des leviers de la résilience libanaise sont en réalité à trouver dans les raisons de sa détresse même. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’antidote est parfois aussi dans le poison, et le sevrage en est d’autant plus difficile. De la même manière, les tentatives récentes de régénération institutionnelle et sociétale ne sont pas dénuées, dans certaines de leurs mécanismes, de menaces contre la stabilité du pays. Elles pourraient, par réflexe de préservation, réactiver les manières de faire à l’origine même des blocages dans lequel le pays est embourbé depuis des décennies.
Crises en cascade, crises enchevêtrées
Le Liban, depuis les années 1970, a été traversé par une série de crises institutionnelles, socioéconomiques et/ou de voisinage, débouchant pour certaines sur des épisodes de violence armée extrêmement déstabilisateurs. Après une guerre civile de 15 ans (1975-1990) qui allait emporter 150 000 Libanais et en blesser 300 0002, la tutelle syrienne sur le pays (1990-2005) mettait l’existence même de ce dernier en danger. Le voisin de l’est déployait à l’occasion une politique d’annexion par le haut, fusionnant les prérogatives régaliennes des deux États, phagocytant la souveraineté et l’économie du Liban à travers une série de traités de codépendance durable. Parallèlement, Israël embarrassait le sud libanais de sa présence armée dès les années 1970, et à travers deux invasions majeures, en 1978 et en 1982, intégrait à sa propre géographie nationale près de 15% du territoire de son voisin du nord.
Ces trois sources de déstabilisation, au-delà de leur violence armée comme symbolique, se sont retraduites par des crises en cascade, multidimensionnelles, d’autant plus difficiles à gérer qu’elles se sont profondément enchevêtrées.
Chacune a tout d’abord nécessité de gérer les pertes économiques et la reconstruction à la fin de chaque épisode violent. La sécurisation de fonds à cet effet est devenue un défi permanent. Les moyens éprouvés de l’État libanais ont très tôt reformulé ce problème en un piège politique. En effet, l’éventualité d’une aide étrangère a rapidement provoqué des crispations autour de la souveraineté du pays et des risques liés à un clientélisme régional ou international trop important. En outre, la reconstruction civile d’après-guerre s’est accompagnée de près de dix ans d’endettement débridé par l’État auprès des banques nationales, et de détournements de fonds publics massifs. Trois décennies plus tard, ces derniers sont en tête des causes de la crise de 2019.
“La société libanaise s’est retrouvée, en 1978 comme en 1982, abandonnée à elle-même.”
Les frictions avec les pays voisins ont en outre structuré un débat récurrent autour des moyens de protéger le territoire et la souveraineté nationale. L’armée libanaise n’a jamais été, de son histoire, capable d’assumer son rôle de défense de l’intégrité du pays. Pourquoi ? La réponse est à chercher dans la nature consociative du régime libanais. Ce terme décrit une organisation politique dont le but est de gérer une société profondément divisée, sur des bases religieuses, ethniques ou linguistiques. Le régime consociatif partage le pouvoir entre les différentes communautés par le biais de quotas ou de postes réservés à certaines parties.
Une telle structure politique présente par définition des institutions étatiques – y compris régaliennes – faibles3. La société libanaise s’est ainsi retrouvée, en 1978 comme en 1982, abandonnée à elle-même lorsqu’il a fallu repousser l’envahisseur venu du sud. En réaction, le Hezbollah était créé en 1982 pour pallier ce besoin en protection militaire. Beyrouth est contrainte depuis à voir son armée cohabiter avec une force armée qui, sans s’en prendre aux civils libanais directement, se dispense de coordonner ses actions avec le gouvernement, et prend le risque de représailles tragiques de la part d’Israël à l’encontre de l’ensemble du territoire libanais.
De manière concomitante, les gouvernements syriens successifs ont rarement, depuis l’indépendance des deux pays dans les années 1940, déployé des politiques facilitant la gestion, par le Liban, de ses affaires internes. L’intervention armée syrienne dans la guerre civile à partir de 1976 se fait à la demande officielle des autorités libanaises. Sans avoir techniquement envahi le pays, Damas a pour autant, et ce dès son entrée en territoire libanais, travaillé à maîtriser le jeu politique de son voisin occidental. La Tutelle (1990-2005), installée avec la bénédiction de la communauté internationale à la sortie de la guerre civile, s’accompagne d’une perte complète de contrôle par les Libanais sur la gestion de la vie institutionnelle du pays. Il faudra attendre 2005 pour qu’un mouvement de protestation populaire massif et appuyé par la France et les Etats-Unis réussisse à mettre un terme à près de 30 ans d’absorption de l’État libanais par l’État syrien.
Des années plus tard, les turbulences au sud et à l’est des frontières libanaises allaient à nouveau déborder sur le pays du Cèdre. La guerre civile en Syrie déverse à partir de 2013-2014 un nombre record de réfugiés sur le Liban (1,5 à 2 millions en 20154), soit un Syrien pour trois Libanais, qui assène le coup de grâce à une trésorerie publique déjà en grande détresse. En 2023-2024, les agressions israéliennes contre le Liban, dans le cadre de la Guerre de Gaza, emportent plus de 4 000 personnes et en blessent près de 17 000. Tel-Aviv en profite également pour réoccuper, a priori durablement, une partie du sud libanais, et se donne la liberté totale et inconditionnelle d’intervenir sur l’ensemble du territoire de son voisin du nord.
Résilience consociative en situation de crise
Comment expliquer, à l’aune d’un tel bilan, le fait que le Liban, État comme société, ait réussi à absorber autant de chocs d’origines et de natures diverses, mais tous hautement déstabilisateurs ?
À la sortie de la guerre civile, et malgré la suspension des hostilités, une grande partie des Libanais maintiennent que leur sécurité sera mieux assurée par des chefs de guerre ayant fait leurs preuves en tant que défenseurs des intérêts de leurs groupes d’appartenance, que par un État (armée et police) faible, auquel il faudra un temps considérable avant de pouvoir assumer efficacement ses fonctions régaliennes. En d’autres termes, la société plébiscite en ses chefs de guerre la classe politique post-conflit, soutenant massivement leur intégration au sein des institutions étatiques.
Ces nouvelles fonctions des anciens chefs de guerre leur permettent d’accéder aux ressources étatiques, qu’ils redistribuent en priorité aux membres de leur communauté. Le clientélisme ainsi décriminalisé consacre les pratiques de prédation d’une classe entière de politiciens en plein cœur de l’État. L’économie de guerre paralégale s’installe en temps de paix en plein cœur de la légalité institutionnelle.
La nature consociative du pays permet à ce modèle de perdurer. Les systèmes consociatifs produisent des États congénitalement faibles, redéfinissant l’appareil étatique comme un réseau d’institutions au rôle avant tout administratif. Les politiques structurantes sont définies à un niveau supranational, par ce qui pourrait être modélisé sous le nom de « Comité souverain des communautés » (CSC). Si son existence n’est pas formalisée dans la Constitution et si elle ne s’est jamais donnée de nom, cette institution officieuse aux effets bien officiels reste la véritable détentrice de la souveraineté du pays.
En corollaire de cette production d’un État-administration, les systèmes consociatifs délèguent le développement de la société aux communautés. Une décentralisation implicite, généralisée, en découle, où chaque groupe confessionnel déroule grâce à des financements assurés par les leaders communautaires, son propre réseau d’action sociale : depuis les hôpitaux, les écoles, les activités culturelles, le tourisme, etc.
“Les systèmes consociatifs condamnent leur pays aux influences extérieures.”
La mafia-isation des postes de pouvoir d’après-guerre amènent un changement de casting, mais pas de modification des règles du jeu. Tant que la redistribution depuis le haut des échelons politiques (financiers, professionnels, etc.) se maintient, les Libanais ne ressentent pas de raison d’en provoquer la réforme. L’État ayant toujours été peu présent dans leur vie au quotidien, son non-retour après les années de guerre n’est pas perçu comme un manque déterminant.
Au cours des 35 dernières années, le système s’est non seulement maintenu, mais renforcé. Premièrement, la disparition des peurs intercommunautaires est lente à s’estomper. Ces dernières favorisent un maintien des chefs de guerre en poste au détriment d’un basculement en faveur d’une classe politique renouvelée et assainie. Voter pour de nouvelles élites reste perçu, encore aujourd’hui, comme un pari sécuritairement risqué.
En outre, les systèmes consociatifs condamnent leur pays à se montrer sensibles à la tentation du parrainage régional. Tant que les débats au sein des CSC aboutissent à des décisions prises consensuellement, le système fonctionne sans accroc. La crise institutionnelle se déclenche lorsque les décisions ne remportent pas la majorité, ou qu’une composante assez puissante menace les autres d’un recours à la force sur le terrain. L’existence d’une partie chargée d’arbitrage et de médiation s’impose comme une nécessité incontournable. Ce qui ouvre la porte aux influences extérieures, sous la forme de parrainages régionaux ou internationaux – que les communautés vont d’elles-mêmes solliciter. En retour de ce parrainage par un État tiers influent, des ressources significatives sont redistribuées à la société par l’intermédiaire des leaders confessionnels, qui en profitent pour fidéliser leurs liens à leurs groupes de soutien et leurs communautés.
Malgré une raréfaction croissante des ressources étatiques sur les dernières décennies, cette pratique permet aux anciens chefs de guerre installés au cœur des institutions de se maintenir. Par ricochet redistributif, et conjuguée à une contribution constante, significative, de la Diaspora libanaise à l’économie nationale5, les sources de financement extérieures restent le pilier essentiel de la résilience socioéconomique de la société libanaise depuis plus de trente ans.
Une résilience sans fin ?
Cette cartographie analytique illustre la nature des défis qui attendent le nouveau gouvernement libanais. L’ancrage profond du mode de survie de la société, arrimé sur le soutien externe et installé depuis des décennies, donne à voir en quoi les refontes structurelles espérées ne sont pas aisées à mettre en place.
La question de l’arsenal du Hezbollah se heurte à une majorité de Libanais, essentiellement chiites (55 % à 60 % de la population) mais pas uniquement, totalement opposés à un désarmement de ce dernier dans un contexte tendu où Israël se dispense de respecter le cessez-le-feu de novembre 2024 et a réinvesti une partie du territoire national. L’avènement d’une armée régulière qui pourrait relever le Hezbollah dans le devoir de protection du territoire comme de la population est mis à mal par des blocages récurrents par Israël lui-même d’une montée en compétences et d’un armement décent des forces nationales libanaises.
Par ailleurs, un soutien actif sur le plan économique, de la communauté internationale comme des parrains régionaux traditionnels (Iran, Arabie saoudite), tarde à se manifester, voire est bloqué pour une partie d’entre eux. L’argent n’est pas uniquement le nerf de la guerre – c’est aussi celui de la paix. Se profile à court terme une incapacité pour l’État libanais à la fois d’assainir ses finances publiques, épurer ses institutions des réseaux clientélistes communautaires, reconstruire les zones dévastées par la guerre de l’automne 2024. Or, sans un plan de financement clair, crédible, appuyé sur un déblocage de fonds prévu dans des délais raisonnables, les dysfonctionnements structurels du système libanais ne sont pas près d’être relégués au passé.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
Le mandat de Michel Aoun, prédécesseur de Joseph Aoun, avait pris fin en octobre 2022.
Sur la guerre civile libanaise, ses causes et ses dynamiques à la fois internes et extérieures, voir Dima De Clerk et Stéphane Malsagne, Le Liban en guerre : 1975-1990, Paris, Belin, 2020.
Sur les institutions en système consociatif, voir Arend Lijphart, Patterns of Democracy, New Haven, Yale University Press, 1999.
Dima El-Khouri Tannous, Nicolas Bautès, Pierre Bergel, « Les réfugiés de guerre syriens au Liban (2011-2016). Quel accès à la ville pour des citadins indésirables ? », in Espaces et Sociétés, 2018, n°172-173, pp. 35-54.
L’Orient-Le Jour, « La diaspora a envoyé 6,7 milliards de dollars au Liban en 2023, selon la Banque mondiale », 30 juillet 2024 – ce qui représente près de 31% du PIB libanais (3e ratio le plus élevé au monde).
À lire aussi
Santé, biodiversité, agriculture : les pesticides cristallisent les oppositions. Derrière le débat politique, une question centrale demeure : quelles...
La science est intimement liée à la politique depuis la Révolution française. Cette connexion s’est traduite par la production d’experts censés...

Transition Écologique & Sociale
Entre régulation et compétitivité, comment engager les entreprises dans la transition écologique et sociale ?
Hier fer de lance du droit européen, les régulations sociales et environnementales des entreprises sont aujourd’hui menacées. Pressions géopolitiques...