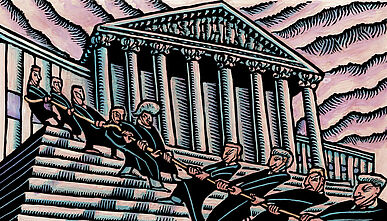Dossier | Comprendre les migrations internationales
Décryptage de la nouvelle loi immigration : renforcer le contrôle des personnes étrangères

Après plus d’un an de discussions, la nouvelle loi sur l’immigration a été promulguée le 26 janvier 2024. Elle marque un durcissement certain du droit des étrangers, pouvant mener à une précarisation de leur statut administratif.
Article de Tanguy Levoyer, doctorant à l’Université Paris Dauphine - PSL (IRISSO).
La « Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » s’inscrit dans un processus de transformation frénétique du droit des étrangers qui a connu 29 modifications législatives depuis 1980. Chacune d’entre elles est censée allier « humanisme » et « fermeté ».
L’exposé des motifs de cette nouvelle loi n’échappe pas à cette règle. Pourtant, tout n’est pas que continuité. Comme cela sera montré dans cet article, les débats parlementaires, comme les contenus initial et final de la loi, témoignent en effet d’une inflexion répressive certaine.
Ce travail s’appuie sur une recherche doctorale commencée en 2020, sur la lecture des rapports parlementaires et la consultation des rapports publiés par la CIMADE et Forums réfugiés.
Une loi au chemin complexe
- Été 2022 : annonce par Gérald Darmanin d’une nouvelle loi sur l’immigration
- Novembre 2022 : interview commune Darmanin-Dussopt dans Le Monde
- Mars 2023 : première lecture au Sénat
- Novembre 2023 : reprise du travail au Sénat
- 11 décembre 2023 : motion de rejet préalable à l’Assemblée nationale
- 19 décembre 2023 : vote définitif de la loi après commission mixte paritaire (CMP)
- 25 janvier 2024 : décision du Conseil constitutionnel (CC)
- 27 janvier 2024 : publication de la loi au journal officiel
Une loi massivement censurée par le Conseil Constitutionnel
Dans sa décision du 25 janvier 2024, le Conseil Constitutionnel (CC) a censuré 35 articles de la loi votée après commission mixte paritaire (CMP), soit près de 40 % des articles. Les restrictions sur les règles du regroupement familial – qui, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, concerne en 2019 environ 12 000 personnes, soit 4,3 % des flux totaux – ou sur la délivrance de la carte « étranger malade » – qui concerne en 2019 environ 5 000 personnes, soit 1,8 % des flux totaux – ont été censurées.
Même conclusion concernant la proposition de conditionner l’octroi de certaines prestations sociales non contributives à un délai de séjour régulier en France égal à 5 ans, la remise en cause du droit du sol pour les personnes nées en France de parents étrangers, l’extension des conditions de déchéance de la nationalité française pour les personnes naturalisées, ou encore la fin du principe d’inconditionnalité de l’accueil dans les hébergements d’urgence.
Si toutes ces mesures ont finalement été censurées, surtout plus sur la forme (cavalier législatif) que sur le fond, elles montrent néanmoins la force des idées issues de la droite et de l’extrême droite au sein du champ politique français. Surtout, la décision du CC ne doit pas faire oublier le contenu de la loi finalement promulguée le 26 janvier 2024.
Une jambe « humaniste » amoindrie
Plusieurs des propositions gouvernementales constituant la « jambe humaniste » du projet de loi ont été profondément amoindries au cours des discussions parlementaires.
Le projet de loi prévoyait la création d’une « carte de séjour temporaire portant la mention travail dans des métiers en tension » à destination des personnes en situation irrégulière (Rapport parlementaire de l’Assemblée nationale, 2 décembre 2023). Dans le projet initial, cette carte était délivrée de plein droit à toute personne étrangère, résidant en France depuis au moins 3 ans, et ayant travaillé au moins 8 mois au cours des 24 mois dans un secteur dit en tension.
La loi promulguée n’aboutit pas à la création d’une nouvelle carte, mais prévoit une procédure dérogatoire à la délivrance de certains titres de séjour pour les personnes étrangères, résidant en France depuis au moins 3 ans et pouvant justifier d’une activité salariée sur une période d’au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois dans un secteur dit en tension. La délivrance n’est plus de plein droit, le pouvoir discrétionnaire du préfet est donc rétabli.
Cette nouvelle procédure de régularisation constitue toutefois une avancée dans le sens où la personne étrangère en situation irrégulière peut désormais demander sa régularisation à la préfecture sans l’autorisation de son employeur, contrairement à l’actuelle circulaire Valls.
Le projet de loi, dans son article 4, offrait également à certains demandeurs d'asile la possibilité d’accéder au marché du travail dès l’enregistrement de leur demande d’asile, réduisant ainsi le délai actuel de 6 mois. Cette mesure, qui avait pour but d'accélérer l'intégration de certains réfugiés, a été supprimée au cours des débats parlementaires.
Enfin, le placement en centre de rétention des mineurs est interdit. Pour rappel, la France a été condamnée 11 fois depuis 2012 par la Cour européenne des droits de l’homme à ce titre.
Un droit au séjour fragilisé
Les mesures d’intégration contenues dans le projet de loi initiale – et finalement maintenues –consistent avant tout à renforcer le niveau de langue française exigé pour acquérir un statut administratif moins précaire.
Actuellement, une personne étrangère, sauf cas particulier, se voit délivrer un premier titre de séjour temporaire d’une année (un visa long séjour valant titre de séjour), et signe un contrat d’intégration républicaine (CIR) dans lequel elle s’engage à suivre des cours de formation civique ainsi que des cours linguistiques si elle ne peut pas justifier d’un niveau au moins égal au A1. Ces cours – entre 200 et 600 heures selon le module – sont délivrés par des prestataires de l’OFII. Si la personne justifie une assiduité dans le suivi de ces cours, elle peut obtenir une carte de séjour pluriannuelle à la fin de sa première année en France (entre 2 et 4 ans).
"L'obligation d’assiduité est donc transformée en obligation de résultat, sans hausse prévue des moyens attribués aux formations linguistiques."
Désormais, cette personne devra justifier d’un niveau de langue au moins égal au niveau A2 à la fin de sa formation linguistique. Un examen de français – oral et écrit – et de formation civique sera organisé à la fin du CIR. En cas d’échec, la personne ne pourra pas obtenir une carte de séjour pluriannuelle, mais simplement une carte de séjour temporaire valable uniquement un an. L’obligation d’assiduité est donc transformée en obligation de résultat, sans hausse significative prévue des moyens attribués aux formations linguistiques.
Le texte final prévoit une hausse du niveau de langue pour la délivrance de la carte de résident. Depuis la loi du 7 mars 2016, une personne étrangère doit justifier d’un niveau de langue écrit et oral égal au niveau A2 pour se voir attribuer une carte de résident valable dix ans. Désormais, le niveau requis sera le B1 écrit et oral.
On observe, de fil en aiguille, la même dynamique pour l’accès à la nationalité française. Les personnes souhaitant être naturalisées devront désormais justifier d’un niveau de langue B2 écrit et oral.
"Le non-respect du contrat devient un motif légitime de refus de délivrance d’un titre pour le préfet"
Désormais, les personnes primo-arrivantes se verront proposer la signature d’un contrat d’engagement républicain, différent du contrat d’intégration républicaine. Par le premier, la personne s’engage à respecter « les principes de la République » comme la liberté d’expression et de conscience ou encore l’égalité entre les femmes et les hommes. La signature de ce contrat conditionne la délivrance du premier titre de séjour ainsi que son renouvellement. Le non-respect du contrat devient un motif légitime de refus de délivrance d’un titre pour le préfet. Le caractère relativement vague de la notion de « non-respect des valeurs républicaines » fait craindre un renforcement du pouvoir discrétionnaire de l’administration.
La course à la réduction des délais de traitement des demandes d’asile
La course à la réduction des délais de traitement des demandes d’asile est une préoccupation constante depuis les années 1980 en France (Akoka, 2020). En 2023, le délai moyen de traitement d’une demande d’asile était de 11 mois au cours de l’été 2023, dont environ 4 mois à l’OFPRA et 7 mois à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
"La formation collégiale laisse plus de place aux débats et harmonise les lectures parfois différentes de la convention de Genève par les magistrats"
Afin d’accélérer le traitement des recours des demandeurs d’asile à la CNDA, la procédure par juge unique devient la règle, et non plus l’exception. Actuellement, lorsqu’un demandeur d’asile est placé en procédure normale, et qu’il n’est pas reconnu réfugié par l’OFPRA, son recours est jugé de façon collégiale à la CNDA. Le magistrat est alors entouré de deux assesseurs dont un est nommé par le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR).
Désormais, tous les dossiers, sauf exception, seront jugés par une seule et même personne. La formation collégiale laisse plus de place aux débats et harmonise les lectures parfois différentes de la convention de Genève par les magistrats.
Cette réforme s’inscrit en outre dans une période de forte pression par les chiffres du ministère de l’Intérieur sur la direction de l’OFPRA, ce qui a entraîné notamment l’organisation de plusieurs grèves par les organisations syndicales de l’établissement à la fin de l’année 2023 et en mars 2024.
Renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière : la clé de voûte du projet du gouvernement
Parmi les mesures administratives, il est important de bien distinguer les arrêtés d’expulsion (AE), des interdictions judiciaires du territoire (IJT) et des obligations de quitter le territoire français (OQTF). Un arrêté d’expulsion est prononcé si la présence d’une personne étrangère représente une menace grave à l’ordre public.
“La loi simplifie la levée de ces protections en cas de condamnation pour un crime ou délit”
En 2022, 341 mesures d’expulsion ont été prononcées dont 161 ont été exécutées. Si certaines personnes (celles arrivées en France avant l’âge de 13 ans par exemple) étaient jusqu’à présent protégées contre ces mesures, la loi simplifie la levée de ces protections en cas de condamnation pour un crime ou délit passible d’au moins 3 ou 5 ans de prison.
Selon la même logique, la loi supprime également les protections de certaines personnes étrangères contre les OQTF. Elle allonge par ailleurs la durée exécutoire immédiate d’une OQTF d’un an à trois ans ainsi que la durée maximale des interdictions de retour sur le territoire français (IRTF). Depuis la loi du 16 juin 2011, l’émission d’une OQTF peut en effet être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans. Cette interdiction pourra désormais s’étendre jusqu’à 5 ans.
La loi prévoit la possibilité d’assigner une personne à résidence pour une durée maximale de 3 ans, contre un an auparavant. Cela concerne notamment le cas des personnes qui sont sous le coup d’une OQTF mais qui, dans les faits, ne sont pas "éloignables" en raison notamment du principe de non-refoulement. En vertu de ce principe énoncé à l’article 33 de la Convention de Genève de 1951, une personne ne peut pas en effet être reconduite vers un pays où elle risque d’être persécutée.
"Le recours à la visioconférence peut constituer une « justice au rabais » au détriment des personnes étrangères"
Sur demande des services de police, le recours de la visioconférence est fortement encouragé dans les zones d’attente et la rétention administrative. Si cela permet de limiter les déplacements pour les agents de police entre le lieu de rétention et le tribunal administratif, le recours à la visioconférence peut constituer, selon certaines associations, une « justice au rabais », au détriment des personnes étrangères.
Enfin, la loi prévoit un ensemble de mesures concernant l’intervention du juge des libertés et de la détention (JLD). L’administration a désormais un délai de 96 heures au lieu de 48 heures avant l’intervention du JLD en rétention. Une personne étrangère pourra donc désormais être plus facilement éloignée avant que les conditions de son interpellation et de sa détention ne soient examinées par le JLD. Comme le souligne la CIMADE, en 2022 ce sont près de « 30 % des personnes enfermées dans les CRA où la CIMADE intervient qui ont été libérées lors du premier contrôle du juge judiciaire ».
Ces évolutions législatives sont à mettre en perspective avec certaines transformations administratives et politiques intervenues depuis une quinzaine d’années en France qui font du ministère de l’Intérieur depuis 2010 le principal propriétaire administratif de cette politique publique, au détriment des ministères du Travail et des Affaires étrangères.
“Un nouveau pacte sur la migration et l’asile est en effet discuté au niveau de l’UE et est sur le point d’aboutir."
Ces évolutions nationales doivent être articulées avec les travaux européens. Un nouveau pacte sur la migration et l’asile est en effet discuté au niveau de l’UE et est sur le point d’aboutir. Celui-ci révise notamment en profondeur les procédures de l’asile en instaurant une nouvelle procédure à la frontière. Dans ce cas, les demandes d’asile seront traitées aux frontières extérieures de l’Union européenne, dans un délai express de douze semaines.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
- Karen AKOKA, L’asile et l’exil: une histoire de la distinction réfugiés-migrants, Paris, La Découverte, 2020.
- CONSEIL D’ETAT, 20 propositions pour simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous, 2020.
- Forums Réfugiés, loi du 26 janvier 2024 "Pour une immigration contrôlée, une intégration réussie", synthèse des principales dispositions, février 2024.
- LA CIMADE, Décryptage de la loi asile et immigration du 26 janvier 2024, 2024.
- LA CIMADE, Décryptage de la loi asile et immigration, 2018.
- Rapport parlementaire de l’Assemblée nationale, au nom de la commission des affaires étrangères, 2 décembre 2023
- Projet de loi de finances pour 2024 : Immigration, asile et intégration. Rapport général numéro 128, tome III, annexe 16, déposé le 23 novembre 2023, Sénat
À lire aussi
Santé, biodiversité, agriculture : les pesticides cristallisent les oppositions. Derrière le débat politique, une question centrale demeure : quelles...
La science est intimement liée à la politique depuis la Révolution française. Cette connexion s’est traduite par la production d’experts censés...

Transition Écologique & Sociale
Entre régulation et compétitivité, comment engager les entreprises dans la transition écologique et sociale ?
Hier fer de lance du droit européen, les régulations sociales et environnementales des entreprises sont aujourd’hui menacées. Pressions géopolitiques...