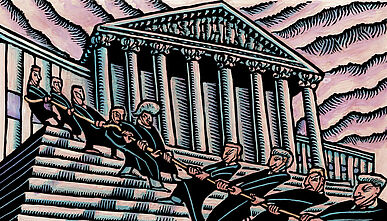Dossier | Genre et inégalités : quand les stéréotypes ont la peau dure
Genre : sens et usages d’une notion devenue polémique
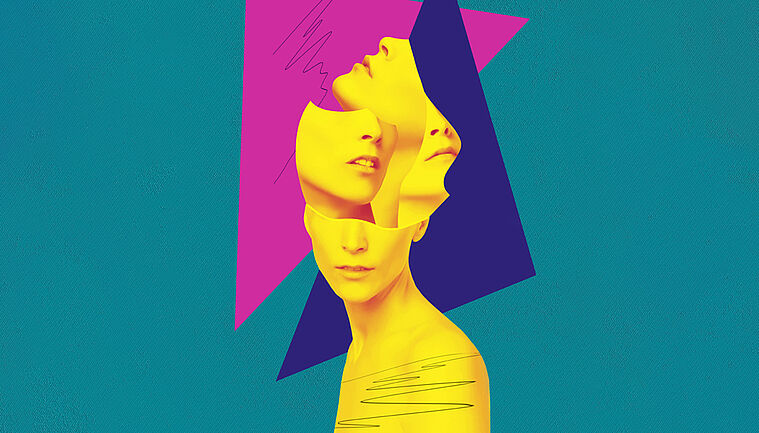
La notion de genre suscite de nombreuses polémiques dans le débat public, souvent alimentées par des mouvements conservateurs. Mais que recouvre vraiment le mot “genre” ? Concept forgé par les sciences sociales, il s'est progressivement diffusé et a été chargé de différents sens.
Depuis plus de dix ans, des mouvements conservateurs, religieux et/ou d’extrême-droite alimentent régulièrement une « panique morale » autour de la « théorie du genre »1. A chaque nouvelle controverse, comme celle de novembre et décembre 2024 au sujet du programme scolaire français d’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle2, les opposants s’élèvent contre une remise en cause de la différence « naturelle » des sexes en s’appuyant sur des interprétations erronées, fantasques ou malhonnêtes de la « théorie du genre ». Ces campagnes, qui visent d’abord à contester les politiques d’égalité des sexes et en faveur des personnes LGBT+, entretiennent alors la confusion sur la notion de genre.
Si cette confusion est sans cesse renouvelée dans le débat public, en dépit des efforts pédagogiques de chercheurs et chercheuses, de militants féministes ou de journalistes, c’est parce que, loin d’être univoque, le terme « genre » recouvre en réalité une variété de sens et d’usages selon les espaces sociaux (recherche, médias, organisations internationales, etc.) et les contextes nationaux. Au sein même de la recherche, on peut également relever des différences entre disciplines et, à l’intérieur d’une même discipline, selon les ancrages théoriques. Cet article entend donc revenir sur ces sens du genre pour offrir des clés de compréhension et tenter de contribuer à un usage raisonné et éclairé du terme « genre ».
Du sexe au genre
Les travaux de l’anthropologue étasunienne Margaret Mead dans les années 1920 et 1930 ou ceux de la philosophe française Simone de Beauvoir dans l’après Deuxième Guerre mondiale constituent des contributions pionnières de la mise en évidence de la dimension sociale et culturelle de la différence des sexes, jusque-là considérée comme un seul fait de nature. Mais le terme « genre » (ou « gender » en anglais) n’apparaît pour la première fois que dans les années 1960 aux États-Unis, par des psychanalystes et psychologues qui s’intéressent à la « transsexualité » ou à l’« hermaphrodisme ». Cette « invention ‘psy’ du genre »3 pose pour la première fois la différence entre le sexe, dimension biologique du masculin et du féminin, et le genre (ou plus exactement l’« identité de genre » - gender identity - ou le « rôle de genre » - gender role), dimension psychologique et/ou sociale du masculin et du féminin. L’objectif est alors de « soigner » les non-congruences sexe/genre pour que l’identité de genre des individus soit conforme à leur sexe.
À ce constat largement descriptif et normatif de la psychiatrie et de la psychanalyse, la sociologue britannique Ann Oakley va donner une dimension sociologique. Dans Sex, gender and society, paru en 1972, elle reprend la différenciation entre sexe, relevant de la nature, et genre, de la culture. Mais elle ajoute que cette dimension culturelle est au cœur des inégalités entre femmes et hommes : ce n’est pas la nature qui attribue des valeurs et comportements de moindre valeur sociale aux femmes, mais la société. Ce déplacement permet d’intégrer les rapports de pouvoir, comme le propose l’historienne étasunienne Joan Scott dans les années 19804, dans la compréhension des différences entre femmes et hommes et suscite l’émergence des études de genre5 en sciences sociales.
Du genre aux genres
Le succès du terme va progressivement en assurer sa diffusion bien au-delà des sciences sociales et, à partir des années 2000, en dehors du monde académique. Selon les cadres théoriques, les disciplines scientifiques, les espaces sociaux ou les contextes nationaux, les sens et les usages vont cependant être variés. On peut néanmoins noter un point commun à ces usages en dehors des sciences sociales : du genre comme dimension sociale de la différence femmes/hommes, on passe aux « genres » comme catégorie descriptive des individus.
Dans de nombreuses publications, par exemple, de psychologie, de sciences de gestion ou d’économie, « les genres » ont désormais remplacé « les sexes ». On retrouve ce même usage dans le débat public (chez des journalistes, dans des sondages, par des intellectuels, etc.). En anglais, le terme gender a largement supplanté le sex. Selon cette acception, l’humanité est divisée en deux genres, femmes et hommes, et chaque personne a un genre (féminin ou masculin). Cette préférence pour « les genres » plutôt que « les sexes » peut viser à insister sur la dimension sociale des différences entre femmes et hommes. Mais son usage routinisé confère un certain flou au sens accordé, et à la place de la nature et de la culture : s’il n’y a plus de sexes, il n’y a plus de différences biologiques ?
L'usage « des genres » apparaît comme une manière nouvelle de dire les catégories « femmes » et « hommes ».
Lorsque Donald Trump déclare, le 20 janvier 2025 : « there are only two genders, male and female »6, il vise pourtant, paradoxalement, à contester toute dimension culturelle de la différence femmes-hommes. Les médias francophones ont d’ailleurs bien souvent traduit par « il n’y a que deux sexes »… Dès lors, cet usage « des genres », dans une visée progressiste ou réactionnaire, apparaît d’abord comme un cache-sexe, soit une manière nouvelle de dire les catégories « femmes » et « hommes ».
Parler « des genres » peut cependant s’inscrire, à l’inverse, dans une perspective radicalement critique de la différence femmes-hommes. La théorie queer, développée dans des cercles militants et universitaires à partir des années 1990, propose ainsi de multiplier « les genres » pour échapper au déterminisme imposé par l’idée d’une différence biologique des sexes. À la suite notamment des travaux de la philosophe étasunienne Judith Butler, il s’agit de dépasser les catégories « femme » et « homme » pour affirmer « son » genre et son identité indépendamment des normes sociales. Si la catégorie « des genres » revêt ici un sens plus stabilisé, elle laisse en partie en suspens la question du sexe : affirmer son genre fait-il disparaître le sexe, au sens de catégorie socialement considérée comme biologique et assignée aux individus dès leur naissance7 ?
Des sexes et du genre
Parallèlement à ces usages, les sciences sociales ont revisité le concept de genre. À partir des années 1990, c’est en particulier la question de la différence « naturelle » qui est interrogée. Loin d’être considérée comme un donné naturel, la différence « biologique » est progressivement perçue comme une production sociale : « le genre précède le sexe »8 selon la formule de la sociologue française Christine Delphy. Autrement dit, il n’y aurait pas deux sexes biologiques sur lesquels la société aurait ajouté du genre, mais bien une pensée de la différence des sexes (le genre) qui divise les individus en deux sexes. Il ne s’agit évidemment pas ici de contester des réalités physiologiques (il existe des corps avec des utérus, des vagins, des testicules, des pénis, etc.) mais de mettre en évidence les processus historiques, sociaux et culturels qui ont simultanément accordé une importance à ces réalités et construit deux catégories radicalement et hermétiquement séparées9.
Le genre n’est pas une caractéristique individuelle mais la structure sociale qui assigne les individus à un sexe.
Dès lors, le genre est le système social qui produit les catégories femmes et hommes et leur contenu. Ou, pour reprendre le manuel de référence en France, « le genre est un système de bicatégorisation hiérarchisé entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et les représentations qui leur sont associées (masculin/féminin) »10. Une telle définition du genre permet aux sciences sociales de rendre compte des processus qui produisent la différence des sexes et, in fine, les inégalités.
Selon cette perspective, le genre n’est pas une caractéristique individuelle mais la structure sociale qui assigne les individus à un sexe : les expressions « les genres » ou « genre féminin »/« genre masculin » n’ont donc pas de sens. Cela ne suppose néanmoins pas des rapports univoques des individus aux catégories de sexe : mais plutôt que de parler « des genres », on parlera d’« identité de genre » pour désigner le rapport subjectif des individus à ces catégories.
Quel est le bon « genre » ?
Ce panorama rapide permet de saisir la diversité des sens et usages du terme « genre ». Au pluriel, il désigne autant une catégorie scientifique et un néologisme de sens commun venant se substituer aux sexes qu’une catégorie militante ou scientifique signifiant la diversité des identifications individuelles. Au singulier, il renvoie à un concept de sciences sociales qui donne à voir et comprendre les processus sociaux de production de la différence et de l’inégalité des sexes.
En circulant entre les disciplines, les espaces sociaux et les pays, le genre a donc été chargé d’une variété de sens. Aucun de ces sens n’est plus « juste » que l’autre, chacun témoignant de la position à partir de laquelle chacun et chacune s’exprime. Néanmoins, cette pluralité appelle certainement à un usage maîtrisé du terme « genre » et à une réhabilitation de la catégorie « sexe ». Lorsque des statistiques distinguent femmes et hommes ou lorsque des discours visent l’appartenance des individus aux catégories « femme » ou « homme », il s’agit bien de « sexe » (et non de « genre »), que le sexe soit pensé comme une donnée biologique ou comme une construction sociale. Sans quoi les instrumentalisations politiques de la science au profit d’un agenda réactionnaire pourront continuer à prospérer.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
Roman Kuhar et David Paternotte (dir.), Campagnes anti-genre en Europe. Des mobilisations contre l'égalité, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 2018.
Voir par exemple : francetvinfo.fr
Eric Fassin, « L’empire du genre. L’histoire politique ambiguë d’un outil conceptuel », L’homme, 2008, n°187-188, p.375-392.
Joan Scott, « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », Cahiers du GRIF, le genre de l’histoire, 1988 [1986], n°37-38, p.125-153.
En France, si l’expression « rapports sociaux de sexe » est un temps privilégiée, le « genre » s’impose à partir des années 1990.
Sur ce point, voir Alexandre Jaunait, « Qu’est-ce que le genre ? », in Frédéric Regard et Anne Tomiche (dir.), Déconstructions queer. Les fondamentaux, Paris, Hermann éditions, 2023, p.33-69.
Christine Delphy, « Penser le genre : quels problèmes ? », in Marie-Claude Hurtig, Michèle Kail et Hélène Rouch (dir.), Sexe et genre. De la hiérarchie entre les sexes, Paris, CNRS éditions, 2002 [1991], p.89-101, p.94.
Anne Fausto-Sterling, Corps en tous genres. La dualité des sexes à l’épreuve de la science, Paris, La Découverte, 2012 [2000].
Laure Bereni, Sébastien Chauvin, Alexandre Jaunait et Anne Revillard, Introduction aux études sur le genre, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2020 [2008], p.8.
À lire aussi
Santé, biodiversité, agriculture : les pesticides cristallisent les oppositions. Derrière le débat politique, une question centrale demeure : quelles...
La science est intimement liée à la politique depuis la Révolution française. Cette connexion s’est traduite par la production d’experts censés...

Transition Écologique & Sociale
Entre régulation et compétitivité, comment engager les entreprises dans la transition écologique et sociale ?
Hier fer de lance du droit européen, les régulations sociales et environnementales des entreprises sont aujourd’hui menacées. Pressions géopolitiques...