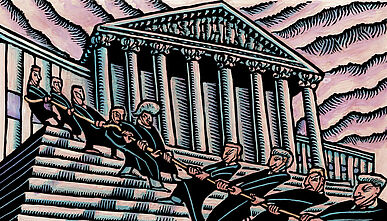Dossier | Genre et inégalités : quand les stéréotypes ont la peau dure
Les ambiguïtés de la parité en politique

Alors que les femmes sont devenues majoritaires dans des professions de prestige comme la médecine ou la magistrature, leur progression en politique reste plus lente et plus contrainte. Quelles spécificités du métier politique freinent la féminisation du pouvoir ?
La féminisation constitue une transformation majeure du champ politique en France au XXIe siècle. Bien que les élites politiques restent socialement et racialement très homogènes, elles incluent désormais des femmes, modifiant ainsi l'image des élus grâce à une plus grande mixité sexuée. Cette féminisation a-t-elle affecté le fonctionnement du champ politique, ce champ de forces et de luttes historiquement masculin ?
Pour analyser les caractéristiques et les effets de la féminisation du personnel politique, il est intéressant de comparer ce processus avec celui à l’œuvre dans d'autres professions et catégories intellectuelles supérieures, et de tenir ensemble les différentes dimensions de la féminisation1. D’abord les conditions historiques de l’entrée et de la progression des femmes en politique, en lien avec les dynamiques générales de la profession. Ensuite les positions réellement occupées, révélant des inégalités persistantes (ségrégation verticale et horizontale) similaires à celles du marché du travail. Et enfin, les enjeux cruciaux d’une évolution conjointe des discours et des pratiques professionnelles.
Les spécificités de la féminisation du métier politique
Le métier politique n’est pas un métier tout à fait comme les autres2 : dénié comme profession, sans parcours académique obligatoire, il repose sur des apprentissages informels, des réseaux partisans, et se trouve soumis aux aléas électoraux. Les conditions de sa féminisation diffèrent également de celles d’autres « professions de prestige »3.
Les femmes représentent ainsi 36 % des députés et des sénateurs.
Tandis que les métiers de la médecine, du barreau, de l’enseignement supérieur ou du journalisme se sont ouverts progressivement aux femmes dès le début du XXe siècle, la politique n’a commencé à les accueillir qu’après la Seconde Guerre mondiale. Longtemps anecdotique, la représentation des femmes n’a réellement progressé qu’avec l’imposition des lois dites sur la parité, qui ont depuis 2000 modifié les règles de candidature aux différentes élections.
Les listes déposées pour les élections européennes, sénatoriales, municipales et régionales doivent désormais être strictement paritaires et alternées - tout comme la composition de leurs exécutifs. De lourdes sanctions financières sont ensuite appliquées aux partis ne respectant pas la parité des candidatures pour les élections législatives. Enfin, un scrutin binominal paritaire a été mis en place pour les élections départementales. En 2025, les femmes représentent ainsi 36 % des députés et des sénateurs, et près de 50 % des conseillers départementaux, municipaux (communes de plus de 1000 habitants), régionaux et européens4.
Cette féminisation est encore plus marquée dans d’autres secteurs professionnels (51 % en médecine, 53 % dans le notariat, 57 % au Barreau, et 71 % dans la magistrature)5 et surtout, elle y résulte non de quotas mais de transformations structurelles, comme l'accès accru des femmes aux formations dédiées et la rationalisation des recrutements via des diplômes et des concours.
La parité contre les monopoles masculins
Autre spécificité, la féminisation de la politique s’est opérée "à postes constants" (bien après les lois sur la décentralisation et la création de nouvelles institutions), ce qui a renforcé les résistances des hommes en place éprouvant directement la mise en cause de leur monopole. À l'inverse, dans d’autres professions juridiques ou médicales, la féminisation a été concomitante de la progression globale des effectifs dans les dernières décennies du XXème siècle, ce qui n’a pas empêché les résistances mais les a atténuées.
Certains partis sont ainsi encore loin de respecter la parité des candidatures.
Les pratiques des dirigeants des partis politiques tendent ainsi à utiliser toutes les marges de manœuvre laissées par la loi pour limiter les effets de la parité : en présentant les femmes candidates dans des circonscriptions difficilement gagnables (en 2024 par exemple, les femmes ont représenté 41 % des candidates et 36 % des élues à l’Assemblée nationale)6, en autorisant des listes dissidentes menées par des hommes, en renouvelant plus vite les élues que les élus7, etc.
Ces pratiques de contournement de la parité sont particulièrement visibles à droite de l’échiquier politique. Pour les élections législatives de 2024, certains partis sont ainsi encore loin de respecter la parité des candidatures et assument préférablement de lourdes pénalités financières (seulement 31 % de femmes candidates pour l’Union des Démocrates et Indépendants et pour Les Républicains8, et 18 % pour « les amis de Ciotti »). Si le Rassemblement National présente 47,2 % de femmes, elles ne comptent que pour 35,6 % de ses députés élus à l’Assemblée, parachutés candidates dans des circonscriptions difficilement gagnables (par exemple à Paris où le RN fait traditionnellement de faibles scores, le parti a présenté 15 femmes et 3 hommes)9.
Une forte ségrégation sexuée, en politique comme ailleurs
Au-delà de ces spécificités, la division sexuée du travail dans le champ politique est relativement similaire à celle qui caractérise l’ensemble des activités professionnelles. Le marché du travail reste profondément structuré par le genre, y compris dans ces professions supérieures qui se sont fortement féminisées dans les dernières décennies.
La division horizontale du travail au sein des professions intellectuelles supérieures montre une concentration des femmes dans des spécialités « relationnelles » (en médecine, elles sont ainsi plutôt en pédiatrie qu’en chirurgie) et sur des statuts moins prestigieux (les femmes représentent 67 % des notaires salariés en 2022)10. Cette spécialisation se traduit par des inégalités financières, particulièrement chez les avocats où les femmes dominent le droit de la famille mais restent sous-représentées dans le droit des affaires davantage lucratif11. La ségrégation est également verticale avec un plafond de verre qui demeure solide, avec par exemple seulement 15 % de femmes parmi les chefs de juridiction et professeurs agrégés de médecine en 201912.
En politique, des mécanismes similaires de ségrégation sexuée persistent. Les femmes sont sous-représentées dans des secteurs valorisés pour leurs compétences techniques (économie, finance, transports) et surreprésentées dans des domaines perçus comme “féminins” (affaires familiales et sociales, santé...). Cela limite leurs opportunités de carrière, ces rôles étant perçus comme le prolongement d’activités naturelles et non comme des compétences et savoir-faire stratégiques.
Un plafond de verre légèrement ébréché
Cette ségrégation horizontale entretient donc la ségrégation verticale des positions politiques. La parité a été plus vite réalisée dans les institutions les moins valorisées du champ politique (conseils municipaux, régionaux, Parlement européen) qu’au sommet.
Les femmes restent largement exclues de la direction des institutions.
Rares sont par ailleurs les femmes qui président les assemblées. En 2025, elles ne représentent que 16,7 % des présidences régionales, 22,2 % départementales, et 19,9 % des maires. Les femmes restent donc largement exclues de la direction des institutions, comme des coulisses et des entourages rapprochés des décideurs.
Il existe quelques notables exceptions qui masquent cette sous-représentation globale. C’est le cas des femmes maires de grandes villes comme Martine Aubry à Lille ou Anne Hidalgo à Paris, ou encore d’Élisabeth Borne nommée à la tête du gouvernement entre 2022 et 2024 (trente ans après Edith Cresson) et de Yaël Braun-Pivet installée au perchoir de l’Assemblée nationale depuis 2022. C’est également le cas de Marine Le Pen, ancienne présidente du Rassemblement national et présente au second tour de l’élection présidentielle en 2017 et 2022. En France comme dans d’autres pays européens13, la direction de partis de droite radicale par des femmes illustre clairement les ambiguïtés de la parité : la progression des femmes en politique n’est susceptible d’améliorer la situation des femmes dans la société qu’à la condition qu’elles soient favorables à l’égalité des sexes.
Cette segmentation interne évite, comme pour d’autres professions prestigieuses, un déclassement14 en réservant l’accès aux positions les plus enviées aux hommes. Rien ne change jamais alors ? L’entrée massive des femmes en politique modifie néanmoins peu à peu le champ politique et ses dynamiques genrées, tout en provoquant de potentiels effets de backlash (retours de bâton).
Des avancées et des retours de bâton
Comme l’ont montré de nombreuses enquêtes15, la féminisation de la politique s’est inscrite dans un contexte de « crise » de la représentation démocratique, où la parité a été justifiée comme un moyen de réenchanter la politique, en supposant que les femmes y apporteraient une sensibilité et des pratiques différentes. Ce discours a sans doute facilité l’inscription de la réforme sur l’agenda politique, mais il a aussi contribué à renforcer les stéréotypes de genre, enfermant les femmes politiques dans des rôles spécifiques dont elles peinent à s’extraire.
Malgré des résistances initiales, la parité est toutefois devenue une norme difficile à critiquer explicitement, et s’est imposée grâce à des lois renforçant son application en politique et étendant sa logique à d’autres domaines professionnels comme la direction des grandes entreprises et la haute administration. Elle représente également le principal horizon des politiques d’égalité des deux dernières décennies, favorisant des mesures très élitaires.
Cette féminisation n’a de fait que peu bouleversé l’élite politique, économique ou administrative, désormais plus mixte mais toujours très homogène sur le plan social et circulant volontiers entre les sommets du pouvoir. Les femmes députées partagent par exemple des profils très similaires à ceux de leurs homologues masculins en termes d’âge, de diplôme et de parcours, bien que leur expérience politique reste légèrement inférieure16.
Le champ politique comme milieu hostile
Les femmes ne sont néanmoins pas encore exactement des hommes politiques comme les autres. Le monde politique reste très concurrentiel, relativement précaire et particulièrement sexiste. L’existence des lois paritaires peut paradoxalement autoriser certains acteurs à penser que tout a été réglé. Or, les femmes politiques qui ont connu des carrières antérieures ou postérieures dans l’entreprise ou la haute administration témoignent toutes de l’âpreté singulière du champ politique. Elisabeth Borne a ainsi récemment raconté son expérience à Matignon en affirmant que « le sexisme est désormais plus encadré dans le monde professionnel qu’il ne l’est en politique. […] Nous avons le droit de faire partie du paysage, mais certainement pas au premier plan »17.
La féminisation doit s’accompagner d’un renversement des valeurs et d’améliorations concrètes des conditions de travail.
Le métier politique, quel que soit l’assemblée d’exercice, reste également marqué par des conditions de travail relativement exigeantes. La disponibilité temporelle qu’il suppose est difficilement compatible avec les charges domestiques que les femmes assument encore majoritairement. Ces freins, combinés à l’exposition à la violence, poussent certaines femmes (davantage que leurs homologues masculins) à quitter volontairement la politique18.
Pour transformer en profondeur les pratiques professionnelles, la féminisation doit s’accompagner d’un renversement des valeurs et d’améliorations concrètes des conditions de travail. Les mobilisations collectives, comme #Metoo politique, ont ainsi permis des avancées notables, notamment dans les partis politiques de gauche, avec la mise en œuvre de dispositifs contre les violences sexistes et des initiatives favorisant l’égalité.
« La bataille » n’est pas finie
Ainsi, l’arrivée massive des femmes en politique n’a pas radicalement transformé les dynamiques du champ. La féminisation actuelle repose sur une forte sélection sociale des candidates, tout en conservant une répartition genrée des responsabilités qui protège le monopole masculin sur les postes stratégiques. Seul un changement profond des normes et pratiques politiques porté par des mobilisations collectives œuvrant pour une égalité réelle, du sommet à la base des organisations partisanes, pourra transformer réellement le fonctionnement du champ politique.

Cet article est publié en collaboration avec The Conversation sous licence Creative Commons.
Ce contenu est publié sous licence Creative Commons
Notes & Références
Guillaume Mallochet, « La féminisation des métiers et des professions. Quand la sociologie du travail croise le genre », Sociologies pratiques, 2007, vol°14(1), p. 91-99.
Etienne Ollion et Sébastien Michon « Retour sur la professionnalisation politique. Revue de littérature critique et perspectives », Sociologie du travail, 2018, 60(1).
Juliette Rennes, Le mérite et la nature. Une controverse républicaine : l'accès des femmes aux professions de prestige 1880-1940, Paris, Fayard, 2007.
Données du Ministère de l’intérieur.
Delphine Dulong, « La résistible ascension des femmes : revue de littérature sur la féminisation des métiers à dominance masculine », Bulletin Académie Nationale Médecine, 2021, n°205, p. 970-975.
Iris Derœux, William Audureau et Romain Imbach, « Candidatures aux législatives 2024 : un nombre en baisse, une parité en recul et des coalitions hétéroclites », Le Monde, 21 juin 2024.
Les listes dissidentes pour les élections municipales ou pour les sénatoriales sont très majoritairement menées par des hommes qui cherchent ainsi à être élus, alors que leur position initiale dans la liste paritaire ne le leur garantissait pas. Le plus fort turnover des femmes élues est également caractéristique de la fragilité de leur processus de professionnalisation (les élues étant toujours susceptibles d’être remplacées par des femmes plus jeunes). Voir Catherine Achin et Sandrine Lévêque, « La parité sous contrôle : égalité des sexes et clôture du champ politique », Actes de la recherche en Sciences Sociales, 204, 14, 2014, p. 118-140.
Ces deux partis perdent donc 57% de la première moitié de leur financement public (proportionnel au nombre de voix obtenu au premier tour des élections législatives), la pénalité financière étant de 150 % de l’écart des candidatures des deux sexes.
Juliette Guéron-Gabrielle, « Comment la parité a reculé à l’Assemblée nationale », Le Monde, 18 août 2024.
Corinne Delmas, “The feminisation of the notary profession in France: end of a patriarchal bastion or sedimentation of a gender stratification?”, International Journal of the Legal Profession, 2023, p.1-33.
Élodie Tuaillon-Hibon et Marjolaine Vignola, « Dynamique et limites de la féminisation de la profession d’avocat·e », Archives de philosophie du droit, 2022, 64(1), p. 133-161.
Delphine Dulong, « La résistible ascension des femmes… », art. cité.
La liste des dirigeantes de partis d’extrême droite est longue : Pia Kjaersgaard pour le Pari populaire au Danemark, Alice Weidel en Allemagne, Giorgia Meloni en Italie, Katalin Novak en Hongrie et Siv Jensen en Norvège. Être une femme leur permet de servir la stratégie de respectabilisation de leur parti en jouant la carte de la féminité et de la politique maternelle pour euphémiser l’approche viriliste du pouvoir dans leur organisation. Elles obtiennent également la confiance des électrices (alors que traditionnellement ces partis ont un important electoral gender gap), en incarnant parfois des formes de progressisme (Marine Le Pen est mère et divorcée ; Giorgia Meloni est séparée). Leur position sur l’avortement et les droits LGBT varie (Giorgia Meloni, actuelle Première ministre en Italie étant plus ouvertement réactionnaire que Marine Le Pen par exemple). Leur point commun réside dans une opposition à l’immigration et un discours antimusulman. Voir Francesca Scrinzi, The Racialization of Sexism: Men, Women and Gender in the Populist Radical Right, Routledge, 2024 ; Frédérique Matonti, Le Genre présidentiel. Enquête sur l’ordre des sexes en politique, La Découverte, 2017.
Marlaine Cacouault-Bitaud, « La féminisation d'une profession est-elle le signe d'une baisse de prestige ? », Travail, genre et sociétés, 2001, 5(1), p. 91-115.
Voir par exemple Catherine Achin, Lucie Bargel, Delphine Dulong et alii, Sexes, genre et politique, Economica, 2007 ; Eléonore Lépinard, L'égalité introuvable. La parité, les féministes et la République, Presses de Sciences Po, 2007 ; Maud Navarre, Devenir élue. Genre et carrière politique, Presses Universitaires de Rennes, 2015.
Sébastien Michon, Louis Casenave, Etienne Ollion et Gaston Vermersch, « La fin du renouvellement ? Portrait social et politique des députés de la XVIème législature », Note de l’Institut des Politiques Publiques, 2023, n°87.
Elisabeth Borne, Vingt mois à Matignon, Paris, Flammarion, 2024, p. 43-44.
Louise Dalibert, Les retraits de la vie politique. Un regard décalé sur la professionnalisation de la vie politique, Thèse de science politique, Université de Nantes, 2022.
À lire aussi
Santé, biodiversité, agriculture : les pesticides cristallisent les oppositions. Derrière le débat politique, une question centrale demeure : quelles...
La science est intimement liée à la politique depuis la Révolution française. Cette connexion s’est traduite par la production d’experts censés...

Transition Écologique & Sociale
Entre régulation et compétitivité, comment engager les entreprises dans la transition écologique et sociale ?
Hier fer de lance du droit européen, les régulations sociales et environnementales des entreprises sont aujourd’hui menacées. Pressions géopolitiques...